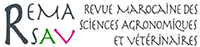Contribution des innovations techniques à la productivité de l’aviculture villageoise à Madagascar
DOI :
https://doi.org/10.5281/zenodo.16752395Mots-clés :
Aviculture villageoise, Innovation technique, Vaccination, Déparasitage, Creep feeder, MadagascarRésumé
L’aviculture villageoise tient une place importante à Madagascar. Elle occupe 83 % de la totalité de la filière avicole et 69,7 % dans le sous-secteur Elevage. L’élevage de poulet occupe la première place avec 83% du cheptel, suivi par le canard (13%), par l’oie (2%) et la dinde (2%). Il constituera une activité génératrice de revenu importante aux exploitants avicoles en cas d’une amélioration. L’objet de cette étude est d’évaluer l’impact de l’introduction de certaines innovations techniques dans la conduite de l’élevage de poulet de races autochtones. De ce fait, la vaccination couplée au déparasitage des poussins et l’utilisation du «creep feeder» pour l’élevage des poussins ont été choisis. L’impact de ces innovations a été évalué sur le taux de mortalité, sur la performance zootechnique des mères poules et sur le revenu généré aux ménages. L’évaluation des résultats obtenus est en faveur des impacts positifs des interventions proposées montrant ainsi la possibilité de l’amélioration des revenus des éleveurs en adoptant ces innovations.
Mots clés: Aviculture villageoise, Innovation technique, Vaccination, Déparasitage, Creep feeder, Madagascar
Téléchargements
INTRODUCTION
A Madagascar, l’agriculture a une grande importance économique et sociale, générant environ 28,4% de la totalité de la PIB (Konaté, 2020). Dans ce secteur primaire, l’élevage occupe une place prépondérante, en particulier les volailles. Le terme «volailles» désigne collectivement les oiseaux domestiques englobant la poule (Gallus gallus domesticus), la dinde (Meleagris ocellata), l’oie (Anser anser), le canard commun (Anas platyrhynchos), le canard de barbarie (Cairina moschata) et la pintade domestique (Numida meleagris). Ces volailles, de races couveuses indigènes ou autochtones, se trouvent généralement dans l’aviculture familiale rurale (MAEP, 2007). Elles constituent la majeure partie de la diversité génétique de la volaille dans le monde (Pym, 2013). A Madagascar, elles constituent le 95% (N=36,5 millions de têtes) du cheptel de volailles selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO, 2013). L’espèce essentiellement exploitée est la poule (Gallus gallus domesticus) de race autochtone appelée “Akoho gasy” (Razafindrafara et al., 2021). En aviculture villageoise, ces poules sont élevées en liberté et représentent 83% du total des volailles (MAEP, 2007), par rapport au 36,5 millions de têtes de volailles domestiques à Madagascar (FAO, 2013).
L’élevage de poule de race autochtone se définit comme la production à petite échelle en divagation, pratiquée dans le cadre du petit élevage extensif par des ménages utilisant la main-d’œuvre dont les travaux ne sont pas rémunérés, et sont effectués par les membres de la famille (Sonaiya, 1999). En général, l’investissement en intrants est minimal et la production est orientée essentiellement vers l’autoconsommation ou l’épargne (Sonaiya, 1990). L’activité met en œuvre une technicité et une production sommaire avec manque d’apport alimentaire, utilisation d’un matériel génétique animal non amélioré et insuffisance de la prophylaxie sanitaire et médicale (Faye, 2022). Ainsi, elle est facile à pratiquer quoique peu rentable. Diverses raisons peuvent conduire également au faible rendement obtenu dans ce type d’élevage. Il est confronté à plusieurs contraintes d’ordre zootechnique, sanitaire et alimentaire. La négligence du coté sanitaire induit une vulnérabilité des volailles face à diverses maladies. En effet, les éleveurs ne suivent pas les programmes de vaccination contre les maladies qui affectent leurs animaux et ne prennent pas de mesures pour lutter contre les infestations parasitaires. Il en résulte une mortalité massive au sein du cheptel entraînant ainsi une faible productivité. Plusieurs maladies menacent l’élevage de poulet villageois, toutefois, la maladie de Newcastle ou MN est désignée comme la principale contrainte sanitaire dans l’élevage de poulets (Al-Shammari et al., 2020). De plus, la productivité de la mère poule de l’aviculture villageoise est victime de comparaisons irrationnelles avec ses cousines pondeuses de race commerciale. Ces dernières pondent 210 à 325 œufs par année suivant les races considérées comme New Hampshire, White Leghorn ou Rode Island (Dudde et al., 2018), tandis que la mère poule autochtone ne ponde que 130 à 153 œufs par année (Koko et al, 2006b). Plusieurs auteurs qualifient la productivité de la mère poule en aviculture villageoise de faible. Toutefois, en plus de ses fonctions de pondeuses, les mères poules effectuent et occupent encore trois autres fonctions. Elles assurent successivement dans le temps les fonctions de couveuse, de nourricière puis d’éleveuse de poussins. Ce type de poule couveuse est adapté aux conditions rurales ne nécessitant pas d’énergie supplémentaire (Azharul et al., 2005; Padhi, 2016).
Le développement de l’aviculture familiale par augmentation de la rentabilité constitue un créneau important dans l’amélioration des conditions de vie des ménages à faibles revenus. De ce fait, les apports des innovations techniques dans le secteur avicole restent indispensables. Les innovations peuvent améliorer la productivité des mères poules tout en augmentant les revenus aux éleveurs. Toutefois, il est essentiel d’évaluer la faisabilité et la viabilité économique des innovations apportées puisque la conception des actions bien conçues et adéquates entraîne une efficacité pérenne. L’objectif de la présente étude est d’analyser l’apport de l’introduction des innovations techniques sur la productivité avicole villageoise à Madagascar. De ce fait, elle compare la productivité de la mère poule de l’aviculture villageoise, le taux de mortalité dans l’élevage et le revenu obtenu avant et après l’introduction des innovations.
MÉTHODOLOGIE
Origine des données
Les données utilisées ont été puisées à partir des résultats de recherche sur l’aviculture villageoise effectuée au sein du FOFIFA-DRZVP et de l’IMVAVET dans le cadre de projets de développement et de projets de recherche (thèse vétérinaire, mémoire d’ingéniorat, DEA/Master II, Doctorat d’université). Ces études ont été réalisées dans les régions d’Analamanga et d’Alaotra Mangoro entre 1998 et 2004 (Koko et al., 2002b), régions de Sofia en 2012 (Maminiaina and Rakotondravao, 2012), région d’Androy en 2012 et entre 2014-2015 (Maminiaina, 2017; Maminiaina and Rakotondravao, 2012), région d’Atsinanana (Andriamaroarison, 2017) et d’Amoron’i Mania (Razafindrafara, 2015). Les données des répartitions spatiales des ménages agricoles à Madagascar identifiées lors de la collecte des données du troisième RGPH réalisé en 2018 par l’INSTAT ou Institut National de la Statistique (INSTAT, 2020) ont été également utilisées.
Types d’innovation apportées et simulations des données
A partir des données disponibles, des simulations ont été effectuées en y introduire deux innovations techniques dans l’aviculture villageoise: la vaccination couplée avec le déparasitage interne et l’installation de «creep-feeder» chez les poussins. Dans la présente étude, l’approche conservatrice consistant à l’introduction d’une innovation tout en gardant le système de production «aviculture type villageois» a été adoptée.
Vaccination contre la maladie de Newcastle et drogage des poussins
Cette première innovation concerne la vaccination contre la MN pour toutes les classes d’âge et le déparasitage interne uniquement chez les poussins.
Vaccination contre la maladie de Newcastle
A Madagascar, trois types de vaccins sont disponibles: Pestavia® (souche Mukteswar vivant - Imvavet), I2 Pestakoho® (souche I2 vivant - Imvavet) et Itanew® (Souche La Sota inactivé - Laprovet®) (Randriamanantena, 2010). Ces vaccins sont tous immunogènes et efficaces contre les souches sauvages de la MN (Maminiaina, 2011). En revanche, ils se différencient par la durée de conservation, la durée d’immunité ainsi que la charge vaccinale annuelle appliquée pour un individu arrivé à l’âge commercial de 7 mois (Tableau 1). La charge vaccinale pour un individu jusqu’à l’âge commercial, varie de 400 Ariary (0,096$) à 500 Ariary (0,12$) tout en incluant l’acte vaccinal des vaccinateurs et les coûts de la chaîne de froid (Tableau 1). Le vaccin Pestavia® produit par l’Imvavet a été utilisée durant la simulation en raison d’une durée d’immunité de 12 mois, ce qui veut dire qu’une seule vaccination a été suffisante pour un individu jusqu’à l’âge commercial (Tableau 1).
Déparasitage interne des poussins
Les deux antiparasitaires adoptés dans cette simulation de déparasitage sont ceux utilisés par les équipes de Koko en 2002 et de Maminiaina en 2017 (Koko et al., 2006b; Maminiaina et al., 2017).
Le premier est un comprimé sécable vitaminé, actif contre les formes adultes des helminthes, contenant de niclosamide (160 mg) et de levamisole (40 mg). Ce comprimé est proposé pour 2 kg de poids vif de volaille. Le deuxième est un anticoccidien à large spectre sous forme de poudre hydrosoluble contenant deux molécules sulfadimerazine (860 g/kg) et diaveridine (105 g/kg). En se basant sur les travaux de l’équipe de Lott en 2003 (Lott et al., 2003), l’anticoccidien a été adapté, en raison de 0,25 g par dose (1 ml), soit 0,25 g/ml (g/v) pour les poussins entre une et trois semaines d’âge.
Sachant que les poussins de 5 jours à dix jours pèsent aux environs de 50 g (Koko et al., 2002a), le comprimé est d’abord écrasé puis dissous dans 10 ml de solution d’anticoccidien (0,25 g/ml) à raison de 0,5 ml/100 g de poids vif (Tableau 2). La solution contenant les antiparasitaires a été donnée aux poussins à l’aide d’une seringue sans aiguille type tuberculine.
L’âge du premier drogage de ces poussins entre le 5ème et 7ème jour d’âge, conçus à titre préventif/curatif, tient compte de la dynamique de l’apparition des maladies parasitaires constatée et expérimentée lors de l’enquête épidémiologique réalisée par l’équipe de Fofifa-Drzvp (Koko et al., 2002a). Par conséquent, chaque couvée reçoit deux traitements espacés de 3 mois, couvrant ainsi normalement toute la période de vie des poussins avec leurs mères (Koko et al., 2006b; Maminiaina et al., 2017). La charge de ces deux drogages pour un individu est égale à la somme de 140 Ariary ou 0,033$ (poids à 5-7 jours = 50 g; poids à 97 jours = 500 g). La première innovation a été résumée sur la figure 1.
Installation de «creep-feeder» pour les poussins
Dans cette deuxième innovation, nous avons proposé l’installation de «creep-feeder» comme accès sélectifs des poussins à la nourriture (Figure 2). Il s’agit d’un type de nourrisseur permettant aux poussins d’avoir accès, par un petit orifice, à un aliment de haute qualité (énergie et protéines) alors que les oiseaux de plus grande taille ne peuvent pas y accéder (Sonaiya et Swan, 2004).
Cette innovation a pour objectif de réduire le temps d’élevage des poussins et d’apporter une supplémentation de la nourriture sans augmenter considérablement la quantité de nourriture donnée au cheptel de la famille. En effet, cette deuxième innovation repose sur les deux principes suivant: (i) le temps disponible pour les mères poules pondeuses augmente lorsque les poussins sont disposés dans un «creep-feeder» après l'éclosion (Prasetyo et al., 1985) et (ii) une meilleure nutrition des poussins renforce leur réponse immunitaire avant ou après la vaccination en développant une résistance face aux maladies (Gunaratne et al., 1994).
En milieu rural, les poulets villageois trouvent principalement leur alimentation quotidienne en fouillant autour des ménages (Dieng et al., 1998). Toutefois, les éleveurs ruraux complètent les alimentations quotidiennes de ces volailles en leur donnant des ordures ménagères, ou des sous-produits céréaliers, généralement le matin ou en fin d’après-midi. Dans cette innovation, chaque ménage fournit environ 200 g (un kapoaka) de riz blanc pour leur cheptel tous les matins et les soirs. Les charges pour l’installation et l’alimentation journalière du cheptel aviaire ont été estimé à 500 Ariary (0,12$) à 1.000 Ariary (0,24$). Pour le «creep-feeder», le coût de la fabrication est négligeable car il est généralement fabriqué avec des produits locaux.
Évaluation de l’application des innovations dans l’aviculture familiale
L’apport de l’introduction de ces innovations dans l’aviculture familiale a été évalué annuellement (i) sur la performance zootechnique et (ii) sur le plan économique.
D’abord, l’impact de ces innovations sur la performance zootechnique annuelle des mères poules a été évalué en terme du nombre des œufs pondus, du nombre de cycle de reproduction par an ainsi que la durée de la période d’éleveuse des poussins (Andriamboahangy, 2017; Koko et al., 2001; Koko, 2002; Koko et al., 2006b; Rakotoarimalala, 2016).
En ce qui concerne l’évaluation de l’importance économique de l’aviculture familiale, l’estimation a été calculée suivant la méthode de Goodger et al. (2002) qui a été utilisée dans le cadre de projets d'amélioration de la production avicole de basse-cour en Afrique: Interventions et leur évaluation économique (FAO/AIEA, 2006). Selon cette méthode, l’apport économique a été exprimé en terme de «Profit net», exprimé en Ariary et en Dollar américain annuel par ménage (Ariary/ménage/an et en Dollars/ménage/an) et de «Rendement».
Le «Profit net» est la différence entre les revenus apportés par l’aviculture villageoise et leurs charges nécessaire pour supporter les innovations (Formule 1).
Profit net = Revenus – charges (Formule 1)
Les «Revenus» utilisés par cette méthode sont les recettes apportées par l’aviculture villageoise après la vente des poules. En revanche, les «Charges» incluent la vaccination de l’ensemble du cheptel aviaire de chaque ménage ainsi que la construction de «creep-feeder», l’alimentation supplémentaire et le drogage des poussins.
Le «Rendement» obtenu après l’introduction de chaque innovation a été calculé avec les charges et les revenus enregistrés annuellement, selon la formule 2 suivant:
Rendement = Profit net/charges (Formule 2)
RÉSULTATS ET DISCUSSION
Aviculture type villageois sans innovation
Race des poules couveuses
En général, les éleveurs villageois malagasy utilisent des races des poules couveuses tel que la volontsipoy (1509 g ± 30; Figure 3A) et la vangamena (2037 g ± 560; Figure 3B). Ces mères poules pondent vers l’âge de 7-8 mois (Koko et al., 2001; Rakotoarimalala, 2016). La sélection de ces races sont des pratiques séculaires millénaires par les éleveurs ruraux qui favorisent certaines races suivant les mœurs, les besoins, la zone agroclimatique du pays et la disponibilité (Banerjee et al., 2014). La volontsipoy dénommée Wyandotte ou poule perdrix maillé doré et la vangamena race multicolore distinctive avec le blanc, le noir et le rouge comme couleurs dominant sont des races très connues respectivement en Amérique du Nord et en Afrique du Sud (Elkhoraibi et al., 2014; Manyelo et al., 2020).
Performance zootechnique des mères poules
Cycle de reproduction
Les mères poules couveuses effectuent à la fois les activités pondeuses, couveuse et éleveuse (Figure 4). Suivant les données obtenues dans les régions d’Analamanga (Koko et al., 2006b), d’Alaotra Mangoro (Koko et al., 2006b; Rakotoarimalala, 2016) et d’Amoron’i Mania (Andriamboahangy, 2017), la durée moyenne du cycle de reproduction de la mère poule est de 127 jours ± 27. Pendant une année, ces mères poules couveuses sont capables de répéter trois fois ce cycle de reproduction avec ou sans période de repos ou inter-couvé (Figure 3). Actuellement, ces mères poules villageoises ont été victimes de comparaison irrationnelle avec sa cousine pondeuse. Certes, les trois activités de la mère poule entraînent un long cycle de reproduction (une couvé). Les auteurs ont tendance à comparer uniquement le nombre des œufs pondus annuellement sans regarder les deux autres activités effectuées et leurs bénéfices pour les aviculteurs ruraux. Aussi, elles sont adaptées à des rudes conditions environnementales et des carences énergétiques en milieu rural. En effet, il faut signaler que les produits de l’aviculture villageoise sont les poussins (viande de poulets gasy) et les œufs qui sont assurés par les mères poules. Ces mères poules sont gardées en divagation et ne reçoivent généralement peu ou pas d’intrants tels que l’alimentation, les soins de santé et le logement particuliers.
Production des œufs et couvaison
La durée de ponte (19 ± 6 jours), est en fonction de rythme de ponte (1,47 ± 0,39 jours/œufs) et de nombre des œufs pondus (11,8 ± 0,98 œufs/couvé; N= 449). Pendant les saisons de récolte des paddy, (saison sèche 52,4% de production annuelle), dans les ménages riches en déchet de cuisine (hôtellerie, gargote), les ménages pratiquants de porciculture ou l’élevage des vaches laitières, les mères poules ont plus des œufs et le rythme de ponte diminue (Koko, 2002; Maminiaina et al., 2007; Rakotoarimalala, 2016). En effet, pendant ces périodes, la base des aliments résiduels picorables (B.A.R.P) qui est défini comme l’ensemble des produits alimentaires accessibles, est proportionnelle à la biomasse totale de la population des volailles (Gunarthne et al., 1994).
Annuellement, une mère poule couveuse pond en moyenne 36,2 œufs (Min: 32,5 et Max: 38,3). Autrement dit, un ménage avec 4 mères poules pondent en moyenne 144,8 œufs ce qui donne entre 129,8 à 153,3 œufs par an. Parmi ces œufs pondus, les 25% (entre 32,5 et 38,3 œufs) sont consommés par la famille et les restes (entre 97,4 et 115,0 œufs) sont utilisés pour produire des poussins. Instinctivement, la mère poule couveuse se met à l’incubation dès que plusieurs œufs sont dans son nid (Hossain, 1993). Il s’agit d’un phénomène physiologique normal lié à la survie de l’espèce qui est contrôlé par au moins deux gènes autosomiques dominants (Romanov et al., 1999). Pendant cette période, différents changements hormonaux s’opèrent en elle avant et pendant la couvaison (Austin et al., 2021). Chez l’espèce poule (Gallus gallus domesticus), cette couvaison dure 21 jours (Bergoug et al., 2013; Métayer-Coustard et al., 2019).
Production des poussins et poulets
A la fin de l’incubation, l’éclosion des œufs donnent des poussins qui sont les produits de l’aviculture des ménages ruraux. Un taux d’éclosion variant de 78,6 à 84,2 % a été constaté dans les régions d’Analamanga (Koko et al., 2006b), d’Alaotra Mangoro (Koko et al., 2006b), et d’Amoron’i Mania (Andriamboahangy, 2017). Le taux d’éclosion varie en fonction des gestions de l’élevage et de l’expérience des poules villageois (FAO, 2010).
Après l’éclosion, les poussins restent avec leurs mères poules en moyenne pendant 87 ± 21 jours (Figure 4). Les mères poules garantissent la sécurité alimentaire et apportent les chaleurs nécessaires aux poussins pendant les premières semaines de leurs développements (Edgar et al., 2016; Edgar et al., 2011). En outre, les poussins sont à l’origine des poulets qui sont utilisés pour la consommation domestique (viande), la génération de revenus et la reproduction. Par conséquent, chaque nouvelle éclosion (nouvelle couvée) constitue un bénéfice pour les ménages ruraux et l’activité d’éleveuse de la mère poule est très importante pour garantir ce bénéfice (Sonaiya et Swan, 2004).
Mortalité
En aviculture villageoise, les mortalités sont énormes et concernent principalement les classes poussines et les poulettes. En effet, la plupart des individus morts proviennent de ces deux classes (n=6,67; 91,5%). Là encore, les poussins se sont montrés encore plus vulnérables avec 66,4% (5,97 par couvé) des mortalités totales (Tableau 3).
En se référant aux différents facteurs à l’origine des mortalités des poussins (807: 66,4% -Figure 5), les parasites internes (319:39,5%) et la MN (201:25%) ont été identifiés comme étant la cause de plus de 64 % des pertes chez les poussins. Quant aux deux autres classes (poulette et adulte), la principale contrainte sanitaire identifiée est la MN: elle est à l’origine des 70% et 73% des mortalités respectivement chez les poulets et chez les adultes.
Résultat économique
Généralement, les poulets villageois atteignent son poids vifs d’abattage entre 1,2 kg et 1,7 kg (moyenne de 1,5 kg) en 6 mois, tout en gardant ses qualités gustatives (Koko et al., 2006a). Sur les marchés ruraux (2022), le prix d’un poulet de 1,5 kg est autour de 18 000 Ariary, soit 4,62$. En se réfèrent au nombre de volaille destinée à la vente et à ces valeurs marchandes des poulets vivants vendus, chaque ménage gagne aux environs de 138 600 Ariary (33$) annuellement. Ainsi, au niveau national, les aviculteurs villageois gagnent aux environs de 61 885 329$ (soit 259 918 381 800 Ariary).
Aviculture type villageois avec apport du déparasitage et de vaccin anti-Newcastle
Mortalité
Selon les recherches menées par les équipes de Koko dans les régions d’Analamanga et d’Alaotra mangoro en 2002 (Koko et al., 2006b) et de Maminiaina dans la région d’Androy en 2014 (Maminiaina et Ravaomanana, 2017), la vaccination contre la MN et le déparasitage des poussins ont été identifiés comme un contributeur significatif à l’augmentation de la productivité de l’aviculture, en termes de réduction de la mortalité annuelle par ménage de 41 en 17 soit 57% (Koko et al., 2001). En effet, la vaccination est perçue comme l’intervention de la santé animale la plus efficace pour la prévention de la morbidité, des complications et de la mortalité dues aux maladies infectieuses comme la MN. De toutes les interventions à caractère sanitaire, la vaccination est l’une des plus fructueuses et des plus rentables qui aient jamais été imaginées (OMS, 2016).
Analyse économique
Sans interventions, chaque ménage gagne annuellement l’équivalent d’une somme égale à 33 $. Ce revenu s’est élevé à 87,9 $ l’année (revenu brut), suite à la vaccination anti-maladie de Newcastle et au déparasitage des poussins sous mère (Tableau 4).
Le tableau financier a fait sortir des Profit net égaux à 54,7 $ et un rendement égal à 303,8 $ (Tableau 5). En intervenant sur la MN et les parasitoses internes des poussins, la productivité de l’aviculture villageoise s’est trouvée fortement améliorée. En effet, en mesurant les impacts de cette intervention en utilisant comme critères le taux de mortalité et le résultat économique, les résultats obtenus se sont montrés positifs.
Aviculture type villageois avec apport de «creep-feeder»
Après la couvaison, la mère poule est constamment en relation avec ces poussins pour leur former à la vie autour des ménages ruraux. Cette activité est obligatoire aux mères poules car les poussins sont fortement exposés aux prédateurs et aux conditions d’environnementales difficiles (Maminiaina et al., 2007). Ainsi, les poussins apprennent beaucoup de leur mère poule sur ce qu’il faut picorer, quand se reposer et comment se comporter en cas de menace (Edgar et al., 2016; Edgar et al., 2011). Au cours de l’apprentissage, les mères poules décourageaient également leurs poussins de consommer des aliments qu’ils considéraient comme inappropriés (Marino, 2013). De ce fait, elles picorent et grattent le sol plus fréquemment pour tenter d’attirer leurs poussins loin de la mauvaise nourriture et vers la meilleure nourriture (Edgar et al., 2016). Également en face des dangers potentiels, les mères poules apprennent, à ses poussins, les différents appels pour désigner les prédateurs aérien comme les rapaces ou des chasseurs au sol comme les rats, les chats sauvages (Marino, 2013).
Sans intervention, la période durant laquelle les mères poules doivent être en constante relation avec ces poussins durent environ 3 mois (87 ± 21 jours). Cependant, l’utilisation du « creep-feeder » aide les poussins à se débrouiller rapidement sans l’intervention permanente de leur mère poule et peut réduire à un mois (30 jours) l’éleveuse des poussins par la mère poule. En effet, dans ce «creep-feeder», il existe de l’abreuvoir et des déchets ménagers riches en protéines et énergies (Georganas et al., 2020) qui vont constituer une partie d’alimentation, renforcer la réponse immunitaire face aux maladies infectieuses et parasitaires aux poussins (Biagini et al., 2022).
L’utilisation de cette innovation permettra à la mère poule d’être libre d’entamer précocement un autre cycle de reproduction. En utilisant le «creep-feeder» aux poussins, le cycle de reproduction dure en moyenne 70 jours, montrant ainsi une augmentation de 2,21 cycles par mère poule/an (Tableau 6). Le nombre d’œufs pondus devient 252 œufs par ménage/an avec 62,9 œufs par poule/an, ce qui permet d’obtenir 188,6 œufs destinés pour la production des poussins. Ce type d’innovation apporte à la fois une amélioration de la croissance et du taux de survie des poussins mais améliore également la performance de reproduction des mères poules (Roberts, 1992). L’équipe de Hossen au Bangladesh (Hossen, 2010), a déjà publié que les interventions sur la gestion des poussins comme l’utilisation de «creep-feeder» ont contribué à l’augmentation de la production annuelle d’œufs de 45 à 96 par poule et la viabilité des poussins est passée de 43 à 87% dans une année.
Le rôle de la volaille dans la réduction de la pauvreté ainsi que la sécurité alimentaire et la promotion de l’égalité des sexes dans les pays en développement est documenté par de nombreux chercheurs (Alders, 2004; Meinzen-Dick et al., 2011). L’aviculture familiale fournit de la viande et des œufs avec des protéines digestibles de haute qualité pour la consommation familiale immédiate et la vente pour générer des revenus pour les familles (Mapiye et Sibanda, 2005; Miao et al., 2005). En effet, à mesure que les revenus augmentent, les gens modifient leur régime alimentaire, incluant généralement plus de produits de l’élevage (Vocke, 1991). Ainsi, l’augmentation des produits de l’aviculture villageoise (viande et revenu) par l’intermédiaire de ces innovations impacterait sur les familles rurales avicultrices.
Choix de l’approche adoptée dans cette étude
Actuellement, deux approches différentes à l’égard du développement de l’aviculture familiale ont été émergées: une approche conservatrice et une approche progressiste. Si la première vise à conserver les pratiques existantes; la deuxième cherche à introduire de nouvelles pratiques. Cette approche progressiste est souvent adoptée par des nombreuses agences de développement qui considèrent que cette stratégie permet de mettre en œuvre des systèmes plus efficaces et plus productifs. En revanche, les résultats économiques et la durabilité des systèmes d’aviculture familiale doivent être pris en compte au moment de recommander la mise en place de systèmes de production plus intensifs. En effet, de nombreux projets ont échoué après avoir adopté des approches et des stratégies inadéquates (Thieme et al., 2014).
Dans le cadre de cette étude, nous avons adopté l’approche conservatrice. Cette approche semble plus appropriée pour les villages reculés ruraux à Madagascar, où l’introduction de nouvelles innovations techniques est difficile à mettre en œuvre et où la production de volailles est soumise à de nombreuses contraintes (Thieme et al., 2014). Il semble que cette approche conservatrice a été adoptée par les communautés rurales depuis des générations (Fotsa, 2008). Aussi, notre expérience de terrain dans le développement de l’aviculture familiale rurale, depuis 1999, montre que les interventions doivent être planifies en plusieurs étapes en raison des nombreux facteurs limitants (Koko et al., 2001; Koko, 2002; Koko et al., 2006b; Maminiaina et al., 2007; Maminiaina and Rakotondravao, 2012; Maminiaina et al., 2017).
CONCLUSION
Pour conclure, l’aviculture est la première étape sur l’échelle permettant aux ménages pauvres de sortir de la pauvreté. Elle est également considérée comme un système de production flexible et facilement adaptable à différentes zones agroécologiques (Ahlers et al., 2009). Toutefois, la négligence du coté sanitaire et le type de système d’élevage adopté sont des freins pour le développement de la filière. Cependant, la vaccination anti-Newcastle, le déparasitage interne des poussins et l’utilisation de «creep feeder» ont amélioré fortement la productivité de l’aviculture villageoise malagasy en diminuant le taux de mortalité des poulets, en augmentant le cycle de reproduction des mères poules, la production d’œufs et le revenu généré par l’exploitation. Les interventions effectuées ont engendré des bénéfices permettra ainsi de dire que l’aviculture villageoise est une activité rentable si on y améliore en introduisant des innovations techniques.
RÉFÉRENCES
Ahlers C., Alders R., Bagnol B., Cambaza A.B., Harun M., Mgomezulu R., Msami H., Pym B., Wegener P., Wethli E. (2009). Improving village chicken production: a manual for field workers and trainers. Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR).
Al-Shammari A.M., Hamad M.A., Al-Mudhafar M.A., Raad K., Ahmed A. (2020). Clinical, molecular and cytopathological characterization of a Newcastle disease virus from an outbreak in Baghdad, Iraq. Veterinary Medicine and Science, 6: 477-484.
Alders R. (2004). Poultry for profit and pleasure. Diversification Booklet n°3 Agricultural Support Systems Division; Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome, Italy.
Andriamaroarison A.T. (2017). Aviculture villageoise face à la maladie de Newcastle dans les communes de Vatomandry. Thèse de doctorat en médecine vétérinaire - DESMV-Faculté de Médecine - Université d'Antananarivo, 120p.
Andriamboahangy H.A. (2017). Aviculture villageoise: performance de productivité de poule locale cas de district de Manandriana. Thèse de doctorat en médecine vétérinaire - DESMV-Faculté de Médecine - Université d'Antananarivo, 99p.
Austin S.H., Krause J.S., Viernes R., Farrar V.S., Booth A.M., Harris R.M., Angelier F., Lee C., Bond A., Wingfield J.C., MacManes M.M., Calisi R.M. (2021). Uncovering the sex-specific endocrine responses to reproduction and parental care. Front. Endocrinol., 12: 631384.
Azharul I.M., Ranvig H., Howlider M.A.R. (2005). Incubating capacity of broody hens and chick performance in Bangladesh. Livestock Research for Rural Development, 17:19.
Banerjee S., Beyan M., Bekele H., (2014). Some traditional livestock selection criteria as practiced by several indigenous communities of Southern Ethiopia. Animal Genetic Resources, 54: 153-162.
Bergoug H., Burel C., Guinebretière M., Tong Q., Roulston N., Romanini C.E.B., Exadaktylos V., McGonnell I.M., Demmers T.G.M., Verhelst R., Bahr C., Berckmans D., Eterradossi N., (2013). Effect of pre-incubation and incubation conditions on hatchability, hatch time and hatch window, and effect of post-hatch handling on chick quality at placement. World’s Poultry Science Journal, 69: 313-334.
Biagini L., Galosi L., Roncarati,A., Attili A.-R., Mangiaterra S., Rossi G. (2022). The role of nutraceuticals and phytonutrients in chickens' gastrointestinal diseases. Animals, 12: 892.
Dieng A., Gueye E.F., Mahoungou-Mouelle N.M., Buldgena A. (1998). Effect of diet and poultry species on feed intake anddigestibility of nutrients in Senegal. Int. Network Fam. Poult. Dev. Newsl., 8: 4-9.
Dudde A., Krause E.T., Matthews L.R., Schrader L. (2018). More Than Eggs – Relationship Between Productivity and Learning in Laying Hens. Frontiers in Psychology, 9.
Edgar J., Held S., Jones C., Troisi C. (2016). Influences of maternal care on chicken welfare. Animals, 6: 2.
Edgar J.L., Lowe J.C., Paul E.S., Nicol C.J. (2011). Avian maternal response to chick distress. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 278: 3129-3134.
Elkhoraibi C., Blatchford R.A., Pitesky M.E., Mench J.A. (2014). Backyard chickens in the United States: A survey of flock owners. Poultry Science, 93: 2920-2931.
FAO (2010). Chicken genetic resources used in smallholder production systems and opportunities for their development, FAO Smallholder Poultry Production Paper No. 5, Rome.
FAO/AIEA (2006). Improving farmyard poultry production in Africa: Interventions and their economic assessment. Proceedings of a final research coordination meeting organized by the Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture and held in Vienna, 24–28 May 2004, 289p.
Faye S. (2022) Amélioration de la productivité et performance de reproduction du cheptel aviaire en milieu rural dans la région de Kolda. Rev. Mar. Sci. Agron. Vét., 10: 85-91.
Fotsa J.C. (2008). Characterization of local chicken populations (Gallus gallus) in Cameroon. Thèse de doctorat, AgroParisTech.
Georganas A., Giamouri E., Pappas A.C., Papadomichelakis G., Galliou F., Manios T., Tsiplakou E., Fegeros K., Zervas G., (2020). Bioactive compounds in food waste: a review on the transformation of food waste to animal feed. Foods, 9: 291.
Goodger W.J., Frank G., Eisele D., Bennett T. (2002). Using partial budgets to assess if the interventions you designed/implemented make more $ than they cost. Proceedings of 3rd RCM, Quatre Bornes, Mauritius, 8 pp.
Gunaratne S.P, Chandrasiri A.D.N., Wickramaratne S.H.G., Roberts J.A. (1994). The utilisation of scavenging feed resource base for village chicken production. Proc. Seventh Asian Australasian Association for Animal Production Congress, Bali, Indonesia 2: 67-68.
Hossain S.M. (1993). Manipulation of the broody period to increase egg production of indigenous hens under rural conditions in Bangladesh. Livestock Research for Rural Development, 5: 13.
Hossen M.J. (2010). Effect of management intervention on theproductivity and profitability of indigenous chickens underrural condition in Bangladesh. Livestock Research for Rural Development, 22 (10).
INSTAT (2020). Résultats définitifs du RGPH-3 2018 - Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitation. Rapport Instat-Madagascar Tome-2.
Koko A., Maminiaina O.F., Rajaonarison J.J. (2001). Développement de l’aviculture villageoise a Madagascar: 40 années d’expérience. Rapport de suivi chercheur, IMVAVET / FOFIFA-DRZV et Projet MAG 10 185.
Koko M., Maminiaina O.F., Ravaomanana J., Rakotonindrina S.J. (2006a). Aviculture villageoise a Madagascar: Productivité et performance de croissance. In Improving farmyard poultry production in Africa: interventions and their economic assessment. IAEA-TECDOC-1489, Vienne, 137 - 145.
Koko M., Maminiaina O.F., Ravaomanana J., Rakotonindrina S.J. (2006b). Impact de la vaccination anti-maladie de Newcastle et du déparasitage des poussins sous mère sur la productivité de l’aviculture villageoise à Madagascar. In Improving farmyard poultry production in Africa: interventions and their economic assessment. IAEA-TECDOC-1489, Vienne, 125-136.
Koko M., Maminiaina O.F., Ravaomanana J., Rakotonindrina S.J. (2002b). Village poultry production in madagascar: Production characteristics and epidemiology. IAEA, International Atomic Energy Agency (IAEA).
Konaté A.K. (2020). Rapport projet d’Appui à la zone de Transformation Agro-industrielle du Sud-Ouest (PATASO) de Madagascar. MinAE - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et Cadre de Plan de Réinstallation (CPR).
Lott B.D., Dozier W.A., Simmons J.D., Roush W.B. (2003). Water flow rates in commercial broiler houses. Poultry Science, 82:102-103.
MAEP (2007). Recensement de l’Agriculture (RA), campagne agricole 2004-2005, Direction du Marketing et des Études Économiques, Service des Statistiques Agricoles, Tome IV, Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, 110-113.
Maminiaina O.F., R.M.S., Adriamaroarison A.T., Randriamamisolonirina T., Miora-Tiana R., Ravaomanana J. (2017). Utilisation de vaccin thermostable I2 contre la maladie de Newcastle (MN) en Milieu réel dans les élevages traditionnels de volailles du District d’Ambovombe. Rapport GRET: Efficacité vaccinale en milieu réel Ambovombe.
Maminiaina O.F. (2011). Caractérisation des virus de la maladie de Newcastle (APMV-1) circulant sur les haute terre de Madagascar. Thèse de Doctorat d’Université, Université d’Antananarivo.
Maminiaina O.F., Koko M., Ravaomanana J., Rakotonindrina S.J. (2007). Epidémiologie de la maladie de Newcastle en aviculture villageoise à Madagascar. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epi., 26: 691-700.
Maminiaina O.F., Rakotondravao R. (2012). Mission préliminaire SUD: Identification et la caractérisation des virus de la MN (APMV-1) circulant dans les autres bassins avicoles de Madagascar (ANDROY et SOFIA) Rapport de mission SUD Tsihombe et Ambovombe FOFIFA-DRZV - Projet MADES – SCAC - Postdoctorale, Laboratoire de virologie.
Maminiaina O.F., Rasamoel P.d.V., Raliniaina M., Ravaomanana J. (2017). Expérimentation sur les moyens de lutte contre les maladies parasitaires internes et la maladie de Newcastle dans un milieu contrôlé à Kianjasoa. Projet coordonné par l’USCP / Financé par l’Union Européenne - GRET/AVSF Rapport - Santé animale FOFIFA-DRZV - Décembre 2015 au Mars 2017, 82p.
Maminiaina O.F., Ravaomanana J. (2017). Utilisation de vaccin thermostable I2 contre la maladie de Newcastle (MN) en Milieu réel dans les élevages traditionnels de volailles du District d’Ambovombe. Rapport GRET: Efficacité vaccinale en milieu réel Ambovombe.
Manyelo T.G., Selaledi L., Hassan Z.M., Mabelebele M. (2020). Local chicken breeds of africa: their description, uses and conservation methods. Animals, 10: 2257.
Mapiye C., Sibanda S. (2005). Constraints and opportunities of village chicken production systems in the smallholder sector of Rushinga District of Zimbabwe. Livestock Res. Rural Dev., 17:115.
Marino L. (2013). The caring chicken – being a mother hen. The Kimmela Center Scolarship - Based Animal Advocacy.
Meinzen-Dick R., Behrman J.A., Menon P., Quisumbing A.R. (2011). Gender: A Key dimension linking agricultural programs to improved nutrition and health. IFPRI, Washington DC, pp. 135-144.
Métayer-Coustard S., Petit A., Quentin M., Tesseraud S. (2019). Nouvelles stratégies alimentaires précoces au service de la production avicole. INRAE Productions Animales, 32: 417-430.
Miao Z.H., Glatz P.C., ., R.Y.J. (2005). Free-range poultry production-A review. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 18: 113-132.
OMS (2016). Stratégies et pratiques mondiales de vaccination systématique (SPMVS)- Document complémentaire du Plan d’action mondial pour les vaccins (PAMV), p87.
Padhi M.K. (2016). Importance of indigenous breeds of chicken for rural economy and their improvements for higher production performance. Scientifica: 2604685.
Prasetyo T., Subiharta W.D., Sabrani M. (1985). The effect of chick and hen separation on village chicken egg productivity. Research Report, Research Institute for Animal Production,Indonesia - 1984/1985, 22p.
Pym R. (2013). Génétique et élevage avicole dans les pays en développement: Diversité génétique des ressources génétiques. Revue FAO du développement de l’aviculture, p. 1-3.
Rakotoarimalala M. (2016). Aviculture familiale à Madagascar: productivité et performance de croissance du poulet de race locale dans la zone forestière de Moramanga (corridor forestier Analamay-Mantadia). Mémoire de fin d’études d’ingénieur agronome - option: élevage, École Supérieure des sciences Agronomiques.
Randriamanantena D. (2010). Efficacité des vaccins contre le virus de la maladie de Newcastle (souches La Sota, Hitschner B1 et Mukteswar). Thèse vétérinaire DESMV, Université d’Antananarivo.
Razafindrafara M.S., Andriatsimahavandy A.A., Koko A., O.F., M. (2021). Overview of domestic poultry farming in Madagascar. International Journal of Agriculture Extension and Social Development, 4: 22-28.
Razafindrafara M.S. (2015). Virus de la maladie de newcastle (APMV-1) circulant dans le district de Fandriana. Mémoire de recherche pour l’obtention du diplôme d’études approfondies (DEA) en sciences de la vie, option biochimie appliquée aux sciences médicales, Université d’Antananarivo.
Roberts J.A. (1992). The scavenging feed resource base in assessments of the productivity of scavenging village chickens, In: Proceedings of an International Workshop on Newcastle disease in village chickens, control with Thermostable Oral Vaccines - 6-10 October, 1991, Kuala Lumpur, Malaysia, 29-32.
Romanov M.N., Talbot R.T., Wilson P.W., Sharp P.J. (1999). Inheritance of broodiness in the domestic fowl. British Poultry Science, 40: 20-21.
Sonaiya E.B. (1990). Rural Poultry in Africa. Comptes rendus de l’atelier international, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigéria, 13–16 novembre 1989, IleIfe, Nigéria, Thelia House Limited.
Sonaiya E.B. (1999). International network for family poultry development: origins, activities, objectives and visions, In: Proceedings of a workshop Poultry as a Tool in Poverty Eradication and Promotion of Gender Equality, March 22-26, 1999, pp. 39 - 50; Tune Landboskole, Denmark.
Sonaiya E.B., Swan S.E.J. (2004). Chapitre 4: Conduite générale de l’élevage, In: Production en aviculture familiale - un manuel technique. FAO Production et santé animale, Rome.
Thieme O., Sonaiya E., Rota A., Alders R., Saleque M., De’ Besi G. (2014). Développement de l’aviculture familiale - Enjeux, opportunités et contraintes. FAO, Rome.
Vocke G. (1991). Investments to transfer poultry production to developing countries. American Journal of Agricultural Economics, 73: 951-954.

Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Fondé(e) sur une œuvre à www.agrimaroc.org.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à www.agrimaroc.org.