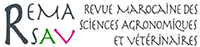Gestion intégrée et conservation des écosystèmes des lisières du Parc National Fazao-Malfakassa (Togo)
DOI :
https://doi.org/10.5281/zenodo.17735250Mots-clés :
Gestion intégrée, Conservation, Open standards, Lisières du PNFM, Pressions anthropiquesRésumé
La gestion et la conservation durable de la diversité biologique et des écosystèmes forestiers constituent un enjeu majeur surtout dans le contexte des changements climatiques et de l’emprise anthropique sans cesse croissante. Comme toutes les lisières des aires protégées, celles du Parc National Fazao-Malfakassa (PNFM) sont victimes de diverses pressions et menaces surtout d’origine anthropique rendant ces écosystèmes des lisières très vulnérables. Cette étude a pour objectif de proposer un plan de gestion intégrée des lisières du PNFM en utilisant l’approche Open Standards for the Practice of Conservation (OS) en se servant de l’outil de planification Miradi 2.0. L’approche utilisée dans cette étude a consisté d’abord à l’identification des cibles notamment les écosystèmes des lisières du PNFM, la connectivité et la fonctionnalité des corridors écologiques ainsi que la faune emblématique. Ensuite, l’identification et l’analyse des menaces a servi à la hiérarchisation des pressions qui pèsent sur la zone d’étude. L’agriculture, la déforestation, les feux de végétation, le surpâturage, les conflits homme-faune, la prolifération des espèces invasives, le développement des infrastructures ainsi que le braconnage sont les plus grandes menaces du milieu. Les résultats ont conduit à l’élaboration de huit axes stratégiques d’intervention. Ainsi, cette étude a contribué à la mise en place d’un plan stratégique de gestion et de conservation des écosystèmes des lisières du PNFM tout en intégrant les besoins socio-économiques des populations riveraines. Ce plan stratégique propose des actions concrètes à entreprendre afin d’assurer une conservation durable et efficace des ressources naturelles des lisières du PNFM.
Mots-clés : Gestion intégrée, Conservation, Open standards, Lisières du PNFM, Pressions anthropiques
Téléchargements
INTRODUCTION
La biodiversité qui est l’ensemble de la diversité biologique contribue efficacement au maintien de l’équilibre planétaire (Biaou et al., 2019). Elle assure également les services écosystémiques et le maintien de l’équilibre écologique (Hussein, 2021; Naeem et al., 2016). Cependant, elle est en perpétuelle dégradation. Dans ce contexte de dégradation permanente des ressources, la conservation de la biodiversité se présente comme l’un des plus grands enjeux environnementaux du XXIe siècle.
La dégradation de la biodiversité dépend de sources multiples. Elle est plus dépendante des activités anthropiques accentuées par une population mondiale en croissance continue. Selon Harfoot et al. (2014), la dégradation de la biodiversité à l’échelle mondiale est causée par l’agriculture intensive, la déforestation, l’urbanisation ainsi que les effets du changement climatique. Ce phénomène entraîne la fragilité, la réduction voire la disparition de la biodiversité. Ainsi, pour pallier ce fléau, plusieurs organisations comme l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ont proposé la mise en place des espaces ayant pour principal but la préservation de la nature appelé aires protégées (AP). Une AP est «un espace clairement défini, reconnus, consacrés et gérés par tout moyen efficace, juridique ou autre afin d’assurer à terme la conservation de la nature, des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associées» (UICN, 2016). À cet effet, elles représentent un pilier de conservation de premier plan en assurant la pérennité des écosystèmes et des espèces (Chape et al., 2005; Dudley, 2008) et offrent un cadre de refuge pour diverses espèces animales et végétales (Woegan, 2011).
En Afrique de l’Ouest, face aux multiples pressions anthropiques qui pèsent sur les écosystèmes naturels, les AP sont devenues une alternative efficace et idéale pour la conservation grâce aux services écosystémiques qu’elles assurent (Hocking et Babbitt, 2014). Les AP sont délimitées par des écosystèmes particuliers appelés lisières. Elles assurent la protection des AP et offrent un cadre idéal d’échange entre le milieu forestier et le milieu non forestiers (Harper et al., 2005). Elles assurent un important rôle de corridor et de liaison étroite entre l’écosystème qu’elle délimite et l’environnement ambiant. Elles ont la capacité d’héberger des espèces spécifiques. Les lisières sont victimes des pressions anthropiques entraînant leur fragmentation et leur dégradation, ce qui les rend de plus en plus vulnérables (Laurance et al., 2000; Laurance et al., 2006). Ainsi, elles perdent leur important rôle de connectivité et de protection des AP. Malgré cette vulnérabilité dont elles sont victimes, les lisières sont ignorées dans la majorité des cas dans les projets d’aménagement et de gestion des AP.
Le Togo, pour mieux assurer la conservation et la préservation de son patrimoine biologique a mis en place plusieurs AP sur l’ensemble du territoire national (Woegan, 2011). Parmi ces AP, le PNFM est la plus vaste. Il est situé au centre du pays et occupe une position stratégique importante. Siège de plusieurs écosystèmes allant des forêts denses aux savanes et des galeries forestières, il abrite une diversité biologique remarquable (Kouamé, 2019). Tout comme les autres lisières, celles du PNFM sont victimes des pressions humaines (Koumoï et al., 2025). Elles restent donc des zones de fortes vulnérabilités écologiques, sociales et économiques malgré la protection du PNFM depuis des années. L’absence d’un cadre méthodologique conciliant la gestion et les besoins des populations locales en est la cause principale. Ainsi, quel mécanisme de gestion intégrée des lisières du PNFM permettrait de réduire considérablement les menaces et d’assurer une conservation efficace en tenant compte des aspirations des populations locales ?
La gestion intégrée des lisières du PNFM nécessite alors une approche qui tient compte de la dynamique écologique, les pressions humaines en tenant compte des besoins des populations locales. Cela passe par la mise en place des objectifs de conservation clairs à atteindre.
Dans ce contexte de dégradation des lisières des AP, il est urgent d’utiliser une méthodologie et des outils bien adaptés afin de mieux assurer la planification et la gestion des lisières dont la santé garantit celle des AP. Pour faciliter cette gestion, il a été mis en place plusieurs méthodologies. Les plus populaires et les plus utilisées sont la méthode Conservation Action Planning (CAP) développé par The Nature Conservancy (TNC). Une variante de CAP encore plus améliorée qui concilie la gestion des écosystèmes et les besoins de la population locale est la méthodologie Open Standards for the practice of conservation (OS). Il a été mis en place en 2007 par Foundation Of Success (FOS) et Benetech avec l’appui de The Conservation Measures Partnership (CMP) et The Nature Conservancy (TNC). Cette méthodologie est principalement basée sur une approche participative et adaptative. Elle permet l’ajustement des stratégies en fonction des résultats obtenus (Salafsky et al., 2002). Cette méthodologie est renforcée par la mise en place du logiciel Miradi 2.0 développé par Benetech et le CMP. Il permet une modélisation entre causes et menaces; les cibles de conservation et les stratégies facilitant la planification et le suivi-évaluation du projet de gestion (CMP, 2014). L’utilisation des OS en association avec Miradi dans la gestion intégrée des lisières du PNFM, est une approche robuste de planification et de la conservation de ces lisières.
Cette recherche est une importante contribution dans la gestion et la conservation durable des écosystèmes des lisières. Plus spécifiquement, elle vise à (1) proposer un modèle conceptuel de conservation (2) Caractériser les principales menaces qui pèsent sur les lisières et enfin (3) proposer un plan de gestion efficace pour la conservation des lisières du PNFM en se servant de la méthodologie OS. Ainsi, cette étude est une contribution significative à la conservation des écosystèmes de lisière et de leurs diversités biologiques en mettant en lumière l’énorme rôle joué par des méthodologies modernes et rigoureuses comme les OS dans la gestion intégrée et dans la conservation durable des ressources. Elle offre donc un cadre de réflexion plus étendu impliquant la conservation et le développement de la population riveraine.
MATÉRIELS ET MÉTHODES
Présentation du milieu d’étude
Le Parc National Fazao Malfakassa (PNFM) est situé au centre-ouest du Togo plus précisément dans la région centrale et de la Kara. Il est dans sa majeure partie localisé dans la préfecture de Sotouboua et se prolonge en petites portions dans la préfecture de Tchaoudjo, Blitta, Bassar et Mô. Il est situé entre les latitudes Nord 8°19 – 9°11 et les longitudes Est 0°36 – 1°27. Il est limité par l’axe routier reliant la ville de Sokodé à celle de Bassar au nord, la rivière Mô et les montagnes de Timbou et de Balanka au nord-ouest, la falaise de Boulohou-Souroukou à l’ouest, la rivière Koui et le parc national de Kyabobo (Ghana) au Sud-Ouest, la rivière Kpawa au sud, les rivières Aou, Woro, Anié à l’Est. Il compte une superficie de 192 000 ha soit 2500 Km2 ce qui équivaut à 4,4% du territoire national. Le PNFM jouit du climat soudano-guinéen et est caractérisé par deux saisons: une saison sèche de novembre à mars qui est marquée par le régime de l’harmattan, un vent sec soufflant des régions sahariennes. Les températures minimales se situent autour de 15°C et les températures maximales autour de 40°C et une saison pluvieuse d’avril à octobre avec une température moyenne de 25°C.
Il appartient à la partie centrale de la chaîne de l’Atacora qui prend en écharpe le Togo. Il est constitué des monts Fazao et Malfakassa entrecoupés par la plaine de la rivière de Mô et ses affluents (Loukoulou et Kamassi). Il est traversé par plusieurs rivières saisonnières tributaires des fleuves Mono et Volta. La figure 1 présente la carte de la zone d’étude.
MÉTHODOLOGIE
Cette étude a adopté la méthodologie Open Standards for des Practice of Conservation (OS) qui est une approche systématique améliorée de la méthode Conservation Action Planning (CAP). Elle favorise une bonne gestion et une planification efficace en rendant la gestion plus adaptative et stratégique. Elle est axée sur sept (7) grandes étapes bien structurées. Il s’agit d’un guide incontournable pour la mise en place et le développement des stratégies ainsi que pour la mesure de l’atteinte des objectifs d’un projet de gestion intégrée.
Étape 1: Établissement du contexte et formulation des objectifs
Il s’agit d’identifier clairement le cadre géographique d’étude c’est-à-dire la zone ou la surface qui est concernée par la planification; analyser le contexte écologique, socio-économique et politique. Il est question également de définir clairement les objectifs de conservation, lesquels doivent être concrets et mesurables.
Étape 2: Identification des acteurs et des parties prenantes
À cette étape, il s’agit d’identifier et de répertorier les ressources humaines participant à la gestion. Il peut s’agir de la communauté locale (CVD, chef traditionnel…), les organisations non gouvernementales (ONG) et même les chercheurs ou experts. Il faut chercher à comprendre leurs intérêts, leurs besoins ainsi que l’influence de chaque acteur dans la gestion et les impliquer directement dès le début du processus de gestion.
Étape 3: Analyse de la biodiversité et identification des menaces
Il s’agit de décrire les habitats, les espèces clés, les services écologiques ainsi que les biens et services fournis par la zone de gestion. Dresser les menaces immédiates et les classer par ordre de priorité selon l’impact de chacune et surtout selon la faisabilité d’action.
Étape 4: Développement des stratégies de conservation
Dans cette étape il faut proposer des actions concrètes qui permettront l’atteinte des objectifs. Ici chaque stratégie doit être reliée aux différentes menaces et aux objectifs de conservation en considérant les contraintes écologiques, sociales et économiques.
Étape 5: Définition des indicateurs et des critères du succès
Il s’agit de définir des indicateurs qui sont non seulement pertinents mais mesurables et de définir des critères de mesure de l’efficacité des actions entreprises afin d’assurer l’évaluation continue du projet de gestion.
Étape 6: Mise en œuvre des actions
Dans la mise en œuvre des actions, il faut faire la planification des actions en fonction du temps et des ressources disponibles en assurant la coordination avec tous les acteurs impliqués. Enfin il faut faire le suivi par des enquêtes auprès des populations et/ou acteurs proches de la surface cible ou en se servant des outils adaptés comme ceux de la GIZ.
Étape 7: Suivi, évaluation et ajustement
Il s’agit de faire une analyse comparative en se servant des résultats capitalisés en fonction des objectifs et des indicateurs fixés au début du processus. Il faut aussi repérer les manquements afin de concilier les actions et les stratégies en fonction des résultats.
Pour rendre la méthodologie OS plus concrète, un logiciel important est utilisé. Il s’agit de Miradi. C’est un logiciel spécialement conçu pour les acteurs de la planification et permet le suivi des projets de conservation. Il a été mis en place en 2007 par Foundation Of Success (FOS) et Benetech avec l’appui de The Conservation Measures Partnership (CMP) et The Nature Conservancy (TNC). Il s’agit d’un logiciel destiné à accompagner les OS et CAP. Il a pour but principal de contribuer à un meilleur suivi et évaluation dans un projet de gestion durable (Patterson et Grundel, 2014). Il s’agit d’un logiciel puissant qui permet aux utilisateurs de faire une évaluation pointue des conditions environnementales afin d’identifier les zones à des valeurs conservatoires élevées (Root, 2003). Il permet de faire une analyse de la situation et une planification stratégique adaptative (Margoluis et al., 2009). Il met clairement les relations existantes entre les cibles de conservation, les menaces et les stratégies proposées. Il permet donc de rendre les OS plus pratiques et opérationnels pour les gestionnaires de terrain (TNC, 2007). Miradi favorise ainsi, la mise en relation des hypothèses des actions et des résultats, processus indispensable dans un projet de gestion durable (Salafsky et al., 2001).
Les composantes des OS sont: le contexte et les objectifs, identification des menaces et des facteurs limitants, définition des objectifs et des résultats escomptés, le développement des stratégies et des plans d’action et le suivi, l’évaluation et l’intégration.
Orientation stratégique de la gestion intégrée des lisières du PNFM
L’orientation stratégique repose sur la vision, l’objectif général et le résultat global attendu.
Vision
La vision de ce plan de gestion intégré est d’assurer la conservation et la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes des lisières tout en intégrant les aspirations communautaires et en agissant sur les facteurs de résilience écologique. Les lisières du PNFM deviendront un espace idéal pour la préservation et la conservation des fonctions écologiques essentielles qui favoriseront le renforcement de la résilience du PNFM.
Objectif général
L’objectif général de ce projet de gestion des lisières du PNFM est de mettre en place une gestion intégrée et collaborative des lisières du parc pour faciliter l’engagement communautaire afin de réduire considérablement les pressions anthropiques qui pèsent sur les écosystèmes et de leurs ressources naturelles des lisières. Il est donc question d’assurer une analyse détaillée et pertinente des menaces qui contribuent à la réduction de la résilience ainsi que de leur capacité d’adaptation. Cela permettra une conciliation entre la conservation des ressources et des écosystèmes, et les besoins des populations riveraines afin de placer les lisières au centre des dynamiques écologiques et multifonctionnelles pertinentes.
Résultat général attendu
À la fin de ce projet, les lisières doivent devenir un cadre idéal de cohabitation et de bonnes relations faune-homme. Ainsi les pressions humaines sur la biodiversité et les écosystèmes des lisières deviendront minimes.
RÉSULTATS
Modèle conceptuel de conservation
La figure 1 est une proposition du projet pour la gestion efficace et la conservation durable des lisières du PNFM. Elle présente les cibles de conservation, les menaces et les stratégies de gestion afin de garantir la conservation durable des ressources naturelles des lisières du PNFM.
Ce graphique illustre principalement les causes des menaces directes qui pèsent sur les écosystèmes des lisières ainsi que les mesures envisagées pour assurer la gestion efficace et durable. Il met en évidence des causes secondaires comme la pauvreté, l’insécurité alimentaire, la croissance démographique. Ces dernières entraînent l’expansion des terres cultivées, le surpâturage, la carbonisation, les feux de végétation. L’absence de surveillance régulière et le contrôle rigoureux engendrent des causes directes ou immédiates qui sont la déforestation, le braconnage, l’exploitation abusive des ressources forestières non ligneuses ainsi que les conflits entre les humains et la faune. Ces menaces conjuguées mettent en péril les écosystèmes des lisières forestières, la connectivité et la fonctionnalité des corridors écologiques ainsi que la faune emblématique. Il met en évidence une proposition de gestion intégrée basée sur le renforcement des mesures de surveillances, la restauration des lisières, la planification participative, l’instauration des activités génératrices de revenus, la promotion des petites entreprises locales de transformation. Cette proposition a pour but principal de réduire la pression sur les ressources naturelles afin d’assurer la conservation durable des écosystèmes des lisières et de la biodiversité qu’ils renferment. Il s’agit d’une approche de gestion qui prend en compte non seulement les défis écologiques mais aussi les enjeux socio-économiques.
Cibles des actions de conservation selon la méthodologie OS
Selon la méthodologie OS, les cibles sont des éléments spécifiques de la biodiversité ou d’un écosystème qu’un projet de gestion et de conservation cherche à restaurer ou à maintenir durablement (CMP, 2020). Elles sont les pièces angulaires du projet car ce sont elles qui orientent les stratégies et les actions. Les cibles peuvent être des espèces, des habitats critiques ou des communautés écologiques qui sont essentielles dans le maintien de l’équilibre et des fonctions écologiques (TNC, 2007). Selon CMP (2020), le choix des cibles repose sur des critères importants. Il s’agit de leur vulnérabilité, la rareté et surtout leur importance écologique dans la zone. Par ailleurs les cibles imbriquées peuvent compléter les cibles principales de conservation mais doivent avoir un lien direct avec celles-ci. Dans la planification basée sur les OS, l’objectif principal du projet est d’assurer la conservation et la restauration des cibles (TNC, 2007). Il est donc indispensable d’identifier les menaces liées à chaque cible. Ensuite les stratégies de conservation, les objectifs et les actions sont clairement définis. Pour chaque cible il faut identifier clairement des indicateurs spécifiques qui permettront de suivre l’évolution des actions engagées dans le processus de conservation durable. Ce suivi est indispensable afin de réajuster les stratégies et les actions en se servant des résultats obtenus (CMP, 2020). Ainsi le choix des cibles est d’une importance capitale pour orienter les efforts de gestion sur des éléments écologiquement indispensables.
Cette étude se repose principalement sur trois cibles : les écosystèmes de lisière, la faune emblématique, la connectivité et la fonctionnalité des corridors écologiques. Chaque cible comporte plusieurs éléments considérés comme des cibles imbriqués. Par exemple les écosystèmes de lisière regroupent les forêts denses, les forêts sèches, les savanes arborées, arbustives et herbacées, le complexe champs/jachères, les plantations. La faune emblématique fait référence aux grands animaux vulnérables victimes des pressions humaines comme les primates, les antilopes, les oiseaux migrateurs, les buffles. Les corridors prennent en compte les couloirs de migration et de transhumance, des pistes et des habitats de transition des mouvements des animaux.
Motivation du choix des cibles
Écosystèmes des lisières du PNFM
Les lisières sont des zones particulièrement fragiles. Elles sont la transition entre le cœur forestier et les espaces anthropisés et assurent un rôle écologique de premier plan. Elles sont les premières à faire face aux différentes pressions entraînant leur forte sensibilité aux perturbations et la réduction de leur rôle de régulateurs écologiques. Les écosystèmes de lisière sont les premiers éléments à faire face aux pressions liées à l’exploitation forestière, aux sur-pâturages, aux feux de végétation, aux activités agricoles limitant ainsi l’exposition du cœur forestier. Elles assurent les services élémentaires essentiels indispensables à la survie de la population riveraine. Ainsi choisir les écosystèmes de lisière comme cible de conservation et de restauration c’est agir directement sur la résilience écologique globale du PNFM en limitant la fragmentation et en assurant la préservation, la conservation et la protection des habitats des espèces du milieu. Ainsi, selon les principes OS, les écosystèmes des lisières du PNFM représentent une cible de premier plan car leurs conservations permettent l’installation d’une forte résilience du PNFM.
Espèces emblématiques
Cette cible regroupe les grands mammifères, les primates, éléphants, buffles, les antilopes, oiseaux migrateurs et autres grands animaux. La présence de ces animaux est révélatrice d’une bonne santé écologique, un bon état des corridors écologiques, une bonne connectivité et la présence des habits propices aux refuges des animaux. Aussi, ces animaux jouent un important rôle écologique fonctionnel de distribution des graines, la régulation de la végétation et assure le maintien efficace du réseau trophique. La méthodologie OS met en évidence la vulnérabilité des lisières liée aux braconnages et au conflit homme-faune. Il est important de cibler ces espèces dans ce projet de gestion afin d’assurer la protection de la biodiversité et la conservation de la diversité biologique mais aussi promouvoir l’écotourisme grâce aux différentes valeurs que possède ces animaux.
Intégrité et fonctionnalité des corridors écologiques
Tous les mouvements des espèces animales sont liés à l’état des corridors. Ils assurent la connectivité entre les habitats des lisières pour assurer le déplacement ou la mobilité des espèces animales. L’absence des corridors provoque l’isolement des animaux brisant ainsi la chaîne et le réseau trophique du milieu. Selon la méthodologie OS, cette cible est indispensable dans l’équilibre écologique. Il est donc important de cibler les corridors afin d’assurer le fonctionnement global des écosystèmes de lisière pour assurer la survie des espèces pour de longues périodes.
Ainsi, le choix de ces cibles repose sur une analyse pertinente de la méthodologie OS basée plus sur la vulnérabilité et la capacité d’adaptation. La protection des lisières et des corridors assure la conservation efficace et durable de la faune. Le tableau 1 fait un bref aperçu sur chaque cible avec précision des indicateurs écologiques clés, les indicateurs spécifiques et les modes d’évaluation (Tableau 1).
Évaluation des menaces dans le cadre des lisières du PNFM
L’évaluation des menaces a consisté à évaluer et ordonner les différents facteurs qui agissent directement sur les cibles à savoir les écosystèmes des lisières du PNFM, la faune emblématique et l’intégrité et la fonctionnalité des corridors écologiques. Dans le cadre de la mise en place de la gestion intégrée par utilisation des OS, cette étape est très cruciale car elle permet d’assurer une gestion durable des écosystèmes, une conservation efficace de la biodiversité afin d’assurer les services écosystémiques. Analyser les menaces permet de les hiérarchiser afin de déterminer la priorité des actions à mener pour atténuer ces menaces.
Dans le cadre de cette étude de mise en place du plan de gestion à travers les OS, l’évaluation des menaces a servi à l’adaptation des plans de conservation en tenant compte de la gravité et de l’urgence des menaces. Elle prend en compte les pressions anthropiques (déforestation, activités agricoles, braconnage, feux de végétation, sur-pâturage) et des facteurs naturels comme les changements climatiques qui agissent directement sur les écosystèmes des lisières du PNFM, la faune emblématique et l’intégrité ainsi que la fonctionnalité des corridors écologiques.
Le classement des menaces est fait en se servant du logiciel Miradi 2.0. Ce logiciel prend en compte trois éléments principaux dans son analyse : la portée, la gravité et l’irréversibilité. L’appréciation est faite sur considération des réalités écologiques et sociale des lisières du PNFM et des enquêtes auprès de la population riveraine.
Selon la définition du logiciel Miradi 2.0, «la portée est définie géographiquement comme la proportion de la cible pouvant être affectée par la menace en dix ans au vu de la poursuite des circonstances et des tendances actuelles. Pour les communautés écologiques, elle est mesurée comme la proportion de l’occurrence de la cible. Pour les espèces, elle est mesurée comme la proportion de la population de la cible». Un niveau faible signifie que la menace est très localisée. Elle touche uniquement une petite partie de la cible (1-10% de son occurrence ou de sa population). Un niveau moyen traduit une menace limitée mais significative affectant une partie importante de la cible (11-30%) de sa population ou de son occurrence. Le niveau élevé identifie une menace qui peut s’étendre à une grande partie de la cible (31-70%). Le niveau très élevé veut dire que la menace est très généralisée et peut affecter l’ensemble de la cible (71-100%).
«La gravité est le degré des dégâts causés à la cible par la menace, degré auquel on peut s’attendre étant donné la poursuite des circonstances et des tendances actuelles. Pour les écosystèmes et les communautés écologiques, elle est typiquement mesurée comme le degré de destruction ou de dégradation de la cible dans la portée. Pour les espèces, elle est généralement mesurée comme le degré de réduction de la population de la cible au sein de la portée». C’est donc le degré de dommage causé à la cible dans la portée. Le niveau faible signifie que la menace entraîne une légère dégradation (1-10%) sur la cible dans 10 ans. Le niveau moyen traduit une dégradation modérée (11-30%). Le niveau élevé correspond à une dégradation importante et sévère qui peut affecter jusqu’à 31 à 70% de la cible. Le niveau très élevé traduit une destruction complète allant de 71 à 100% de la cible dans 10 ans.
«L’irréversibilité ou la permanence est le degré pour lequel les effets de la menace peuvent être inversés et la cible, affectée par la menace, restaurée». Pour ce paramètre, le niveau faible fait référence aux effets facilement réversibles de la menace avec une restauration possible dans 0-5 ans à faible coût. Le niveau moyen signifie que la restauration des effets de la menace est possible avec un investissement raisonnable. Elle peut prendre 6-20 ans. Le niveau élevé exprime une restauration techniquement possible mais très coûteuse et peut prendre assez de temps (21-100 ans). Le niveau très élevé traduit une situation pratiquement irréversible avec des dégâts et dommages énormes. C’est le cas où la fonction écologique ou la biodiversité sont définitivement perdus. Il faudra énormément de temps (plus de 100 ans) pour assurer une restauration partielle des effets de cette menace.
Caractérisation des principales menaces
Les différentes menaces agissent sur toutes les cibles. Cependant dans cette étude l’analyse a privilégié les menaces qui agissent directement sur les cibles. Il faut noter qu’une menace peut agir directement sur plusieurs cibles.
Déforestation
La déforestation entraîne la perte significative de la biodiversité. Elle est jugée très élevée sur les écosystèmes de lisière. La déforestation provoque la fragmentation des habitats et limite la mobilité des espèces, ce qui compromet la viabilité de la connectivité et de la fonctionnalité des corridors. Cette menace est liée aux activités agricoles, à l’expansion de la surface cultivée et à l’exploitation excessive et incontrôlé du bois (de chauffe, d’œuvre). Elle réduit la résilience écologique face aux différentes pressions humaines et naturelles.
Le braconnage
Cette menace est qualifiée de très élevé et élevé respectivement pour la faune emblématique et l’intégrité et la fonctionnalité des corridors écologiques. C’est une menace qui agit directement sur les espèces animales en réduisant le nombre d’individu. Aussi, il entraîne la rupture de l’équilibre social des espèces. Cette activité illégale est tributaire d’un manque cruel de surveillance et d’une faible participation communautaire dans la gestion des lisières du parc.
Feux de végétation
Les feux de végétation communément appelés feux de brousse ont un impact moyen sur la faune emblématique et élevé sur les écosystèmes des lisières, ce qui compromet indirectement les corridors écologiques. Ils détruisent les animaux du sol et la microfaune, impact négativement, altèrent la qualité du sol et détruisent la végétation des lisières. Les feux de végétation accentuent la vulnérabilité des écosystèmes face aux espèces invasives ou opportunistes. Ils contribuent indirectement à la fragmentation des habitats. Ils sont causés par les activités humaines (volontaire ou involontaires) et les activités agricoles.
Conflits homme-faune
Le conflit homme-faune est considéré comme élevé sur la faune emblématique. En effet, elle entraîne des mortalités élevées par des représailles, le braconnage, la chasse excessive, la pêche illégale. Il tire son origine de la non implication de la population dans les stratégies de gestion et surtout du manque ou de l’insuffisance de la surveillance. Il perturbe la dynamique des populations animales et envenime l’état des espèces vulnérables.
Surpâturage
Le sur-pâturage est une menace évaluée comme un impact élevé sur la faune emblématique, et moyen sur les écosystèmes de lisière ainsi que sur la connectivité et la fonctionnalité des corridors. Il provoque le stress et mort de plusieurs animaux sur les plus petits. Il provoque également la fuite des grands animaux et la destruction de la végétation. Le sur-pâturage entraîne une complétion entre le bétail et la faune sauvage. Il dégrade le sol et modifie la composition de la communauté végétale du milieu et compromet la régénération naturelle des espèces.
Activités agricoles
Les activités agricoles ont un impact élevé également sur les écosystèmes de lisières. Elles sont responsables de la fragmentation de l’habitat, de la pollution du sol et même de la destruction des espèce végétales. Ces impacts rendent difficiles la survie de la faune emblématique et déséquilibre la chaîne écologique.
Espèces invasives
L’introduction des espèces invasives à un impact négatif sur la biodiversité et plus particulièrement sur les écosystèmes de lisières. Elle est considérée comme ayant un impact élevé sur les écosystèmes de lisière surtout les écosystèmes forestiers. Elles installent la compétition, perturbent les interactions trophiques et modifient l’équilibre écologique.
Les changements climatiques
Les changements climatiques ont un impact élevé sur les écosystèmes de lisière. Ils modifient le régime de température et de pression et augmentent le stress de la végétation. Les changements climatiques contribuent à la mauvaise répartition des espèces; ce qui rompt l’équilibre écologique. La sécheresse récurrente et les variations climatique poussées rendent difficile l’adaptation et la résistance de la végétation surtout les espèces à faible résilience, ce qui provoque le recul du couvert végétal. Ce recul compromet indirectement la survie et la mobilité des animaux.
Surexploitation des PFNL
L’utilisation non durable des produits forestiers non ligneux (PFNL) entraîne une réduction de la capacité naturelle de régénération. Les PFNL désignent ici toutes les ressources autres que le bois d’énergie et de construction issues des forêts. On peut citer les fruits, les graines, les feuilles, les champignons, le miel, escargots gibiers et autres. La surexploitation entraîne la perte de la biodiversité, la dégradation des habitats, la perte de la résilience et un déséquilibre écologique total. Cette menace a un impact moyen sur les écosystèmes des lisières ainsi que l’intégrité et la fonctionnalité des corridors écologique
Infrastructures
L’analyse des menaces citées ci-dessus montre que les principales qui affectent énormément les cibles sont plus d’origine anthropique. Leurs effets sont aggravés par les changements climatiques. Les cibles les plus affectées sont respectivement; les écosystèmes des lisières (impact très élevé), la faune emblématique (impact élevé) et l’intégrité et la fonctionnalité des corridors (impact moyen). L’évaluation intégrale du projet montre que l’impact global de toutes ces menaces est très élevé.
Les menaces les plus critiques sont: la déforestation, le braconnage, les activités agricoles, les feux de végétation, les feux de végétations, le sur-pâturage intensif, les espèces invasives, conflit homme-faune et les effets des changements climatiques. Vu l’ampleur de ces impacts, la complexité de ces menaces et l’interaction entre ces menaces, les cibles sont fortement exposées. Il est important de mettre en place une planification de la conservation prenant en compte les aspirations de la population. Cette planification doit prendre en compte toutes ces menaces en intégrant à la fois les communautés locales, les autorités et les organisations internationales et les ONG. Il s’agit d’une planification collaborative visant la restauration, la conservation et la préservation des écosystèmes y compris la faune et la connectivité écologiques. Le tableau 2 montre toutes ces menaces accompagnées de leur impact direct sur la cible concernée.
Plan stratégique
Le plan stratégique comprend le plan d’action et le plan de suivi.
Plan d’action
Un plan d’action comprend les stratégies pour surmonter les causes de la dégradation des cibles en détaillant des objectifs spécifiques après identification des menaces (Patterson et Grundel, 2014). Les objectifs diffèrent en fonction des résultats à attendre. Les objectifs visent à réduire l’impact des menaces, assurer la restauration écologique, promouvoir l’exploitation rationnelle de la biodiversité et améliorer les pistes. Le tableau 3 résume les stratégies, les objectifs et les différentes actions.
Plan de suivi
Dans un projet d’aménagement et de gestion, le plan de suivi est un élément clé qui permet une bonne évaluation des résultats afin de réajuster les défaillances pour minimiser l’impact des menaces. Dans cette proposition de gestion intégrée des lisières du PNFM basée sur les OS, les indicateurs indispensables au suivi et à l’évaluation sont résumés dans le tableau 4.
DISCUSSION
La dégradation des écosystèmes forestiers de par le monde est une réalité. Pour Atakpama et al. (2023), cette dégradation prend une allure très alarmante. Ce fléau tire ses origines au Togo des troubles socio-économiques traversés par le pays dans les années 1990 (Fousséni et al., 2025; Polo-Akpisso et al., 2016). Ces troubles ont entraîné l’envahissement des AP et l’installation des populations dans les lisières forestières. Le PNFM fut l’une des AP les plus affecté par cet envahissement. Cela a provoqué la multiplication des activités humaines telles que l’agriculture, le braconnage, l’exploitation du bois, le pâturage. Cependant, la population riveraine bien que dépendante du parc pour sa subsistance n’est pas sérieusement impliquée et s’intéresse très peu à sa gestion et à sa conservation. Dans ce contexte de multiplication des pressions humaines dans les lisières couplées à la négligence de la population, le PNFM perd graduellement sa résilience et sa capacité d’adaptation face aux enjeux des changements climatiques. Ainsi l’élaboration d’un plan de gestion qui prend en compte la conservation durable des ressources des lisières du PNFM et les aspirations des populations est une alternative pour augmenter la résilience du parc et de ses lisières. Ce plan de gestion intégré basé sur les Open Standars for the Practice of Conservation (OS) permet de concilier la conservation et les aspirations profondes des populations. Ce plan de gestion est similaire à celui de Badjare (2025) qui a utilisé l’outil CAP qui est une variante des OS pour proposer un plan de gestion et de conservation des AP du Togo. Les résultats de cette partie du mémoire confirment que seule la gestion participative telle que préconisée par Harper et al. (2007) et Sawadogo et al. (2022) peut garantir la durabilité des actions de conservation dans les lisières du PNFM car l’expérience de la gestion des AP en Afrique de l’Ouest a montré les limites des approches coercitives basées sur l’exclusion des populations (Hulme et Murphree, 2001). Dans le cas des lisières du PNFM, elle doit reposer sur la mise en place des activités alternatives viables comme l’apiculture, l’agroforesterie ou encore la valorisation et l’organisation de la filière des PFNL. L’atout majeur des OS réside dans leur capacité d’adaptation. Elles permettent une incorporation facile des résultats de suivi écologique ainsi qu’une prise en compte des résultats scientifiques et les savoirs locaux. Selon Margoluis et al. (2009), la gestion adaptative est indispensable dans les écosystèmes soumis à des pressions anthropiques continues, car elle permet d’ajuster les dynamiques complexes et évolutives des écosystèmes.
CONCLUSION
Les pressions anthropiques qui pèsent sur les lisières du PNFM sont croissantes et variées. Les plus récurrentes se réfèrent aux activités agricoles (défrichement, feux de végétation……), à l’exploitation forestière conduisant à la dégradation des écosystèmes de lisière et des corridors écologiques ainsi que des conflits entre les hommes et la faune. L’utilisation de l’approche OS qui est une méthodologie efficace de gestion durable et de planification permet d’assurer une conservation notable de toutes les cibles victimes des menaces. Elle a permis l’identification des menaces, les cibles ainsi que des objectifs et stratégies de conservation qui ont favorisé l’orientation des actions pour une conservation durable des lisières. Les trois cibles principales qui ont été choisies sont: Les écosystèmes de lisière, la connectivité et la fonctionnalité des corridors écologiques et les conflits homme-faune. Le plan stratégique proposé constitue une base scientifique solide pour assurer une gestion durable des lisières du PNFM. Le suivi de ce plan stratégique proposé permettra de réduire ou de minimiser les différentes menaces qui pèsent sur ces écosystèmes. Cette étude a démontré la force des OS dans la conciliation entre la conservation et le développement de la communauté locale. Ainsi il est indispensable d’assurer une conservation efficace tout en préservant les valeurs et les axes de développement des riverains d’où la nécessité d’une gestion participative.
RÉFÉRENCES
Atakpama W., Egbelou H., Kombate B., Biaou S., Batawila K., Akpagana K. (2023). Diversité et structure des formations végétales de la forêt communautaire d’Alibi-1 au Togo. Synthèse: Revue des Sciences et de la Technologie, 29: 6-20.
Badjare B. (2025). Suivi de la productivité des écosystèmes suivant les gradients environnementaux majeurs au Togo. Thèse de Doctorat, Université de Lomé.
Biaou S., Houeto F., Gouwakinnou G., Biaou S.S.H., Awessou B., Tovihessi S., Tete R. (2019). Dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol de la forêt classée de Ouénou-Bénou au Nord Bénin. Conférence OSFACO: Des images satellites pour la gestion durable des territoires en Afrique.
Chape S., Harrison J., Spalding M., Lysenko I. (2005). Measuring the extent and effectiveness of protected areas as an indicator for meeting global biodiversity targets. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 360: 443-455.
CMP (2020). The Open Standards for the Practice of Conservation. Version 4.0. CMP, Washington D.C.
CMP (2014). Miradi 4.4 User Guide. Palo Alto, CA: Benetech.
Dudley N. (2008). Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées. IUCN.
Fousséni F., Maza-Esso B.D., Wouyo A., Bilouktime B., Šinžar-Sekulić J., Kperkouma W., Komlan B., Koffi A. (2025). Floristic diversity and assessment of the conservation status of Togo’s plant species. PhytoKeys, 261: 211.
Harfoot M.B., Newbold T., Tittensor D.P., Emmott S., Hutton J., Lyutsarev V., Smith M.J., Scharlemann J.P., Purves D.W. (2014). Emergent global patterns of ecosystem structure and function from a mechanistic general ecosystem model. PLoS biology, 12: e1001841.
Harper K.A., Macdonald S.E., Burton P.J., Chen J., Brosofske K.D., Saunders S.C., Euskirchen E.S., Roberts D., Jaiteh M.S., Esseen P.A. (2005). Edge influence on forest structure and composition in fragmented landscapes. Conservation Biology, 19: 768-782.
Harper K.A., Mascarua-Lopez L., Macdonald S.E., Drapeau P. (2007). Interaction of edge influence from multiple edges: examples from narrow corridors. Plant Ecology, 192: 71-84.
Hocking D.J., Babbitt K.J. (2014). Amphibian contributions to ecosystem services. Herpetological Conservation and Biology, 9:1−17.
Hulme D., Murphree M. (2001). African wildlife and livelihoods: the promise and performance of community conservation.
Hussein A. (2021). Links between biodiversity, ecosystems functions and services: systematic review. Int. J. Ecotoxicol. Ecobiol., 6: 70-79.
Kouamé K.W. (2019). Côte d’Ivoire: les aires protégées entre politique de conservation contrastée et réinterprétation sociale. Études caribéennes, (43-44).
Koumoï A., Fousseni F., Lankondjoa K., Madjouma K., Wala K., Komlan B., Koffi A. (2025). Perceptions endogènes des impacts écologiques liés aux activités anthropiques sur les lisières du Parc National Fazao-Malfakassa (Togo). Revue Ecosystèmes et Paysages, 5: 1-24.
Laurance W.F., Delamônica P., Laurance S.G., Vasconcelos H.L., Lovejoy T.E. (2000). Rainforest fragmentation kills big trees. Nature, 404: 836-836.
Laurance W.F., Nascimento H.E., Laurance S.G., Andrade A., Ribeiro J.E., Giraldo J.P., Lovejoy T.E., Condit R., Chave J., Harms K.E. (2006). Rapid decay of tree-community composition in Amazonian forest fragments. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103: 19010-19014.
Margoluis R., Stem C., Salafsky N., Brown M. (2009). Using conceptual models as a planning and evaluation tool in conservation. Evaluation and program planning, 32: 138-147.
Naeem S., Chazdon R., Duffy J.E., Prager C., Worm B. (2016). Biodiversity and human well-being: an essential link for sustainable development. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 283: 20162091.
Patterson T.A., Grundel R. (2014). Conservation Action Planning: Lessons learned from the St. Marys River watershed biodiversity conservation planning process. Journal of Great Lakes Research, 40: 7-14.
Polo-Akpisso A., Wala K., Ouattara S., Foléga F., Tano Y. (2016). Changes in land cover categories within Oti-Kéran-Mandouri (OKM) complex in Togo (West Africa) between 1987 and 2013. In Implementing Climate Change Adaptation in Cities and Communities: Integrating Strategies and Educational Approaches (pp. 3-21). Springer.
Root W. (2003). Conservation Action Planning: Developing Strategies, Taking Action, and Measuring Success. The Nature Conservancy, Arlington, VA.
Salafsky N., Margoluis R., Redford K.H. (2001). Adaptive management: a tool for conservation practitioners.
Salafsky N., Margoluis R., Redford K.H., Robinson J.G. (2002). Improving the practice of conservation: a conceptual framework and research agenda for conservation science. Conservation Biology, 16: 1469-1479.
Sawadogo B., Yaméogo A., Zabre N., Bonkoungou J. (2022). Impacts des actions Anthropiques sur la dynamique de la forêt classée de Tiogo (FCT) Dans un contexte de gouvernance centralisée. Int. J. Progress. Sci. Technol, 34: 240-250.
TNC (2007). Conservation action planning handbook: developing strategies, taking action and measuring success at any scale. The Nature Conservancy, Arlington, VA.
UICN (2016). Rapport annuel 2016. Le milieu naturel de la Côte d’Ivoire.
Woegan Y.A. (2011). Diversité des formations végétales ligneuses du Parc national de Fazao-Malfakassa et de la réserve d’Aledjo (Togo). Acta Botanica Gallica, 158: 445-449.

Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Fondé(e) sur une œuvre à www.agrimaroc.org.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à www.agrimaroc.org.