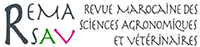Pratiques de gestion des eaux usées à Porto-Novo au Bénin
DOI :
https://doi.org/10.5281/zenodo.16729924Mots-clés :
eaux usées, assainissement, gestion, discrimination, Porto-Novo, BéninRésumé
La lagune de Porto-Novo est le réceptacle principal de toutes les eaux usées de la Commune par le biais des caniveaux. L’objectif de l’étude était d’analyser le système de gestion des eaux usées de la commune de Porto-Novo afin d’apprécier les risques de leur rejet sans traitement dans la lagune. A cet effet, une caractérisation des eaux usées avait été faite après une enquête auprès des ménages. Les résultats obtenus révèlent que les maisons représentaient la source la plus abondante (55,8%) suivies des ateliers (21,9%). 94%, 92%, 79% et 50% des ménages enquêtés rejetaient respectivement les eaux de lessive, de vaisselle, de douche et des eaux vannes dans la nature. 42,5% des ménages enquêtés avaient accès à un système d’assainissement approprié. Les latrines et les douches étaient les structures d’assainissement les plus utilisés par les populations à Porto-Novo. L’analyse en composantes principales a révélé trois groupes d’eaux usées : eaux usées des abattoirs, des ateliers et des établissements humains. Les analyses physico-chimiques et bactériologiques avaient indiqué que les eaux usées avaient une contamination organique et microbiologique puis sont hors des normes de l’OMS et du Bénin. La majorité des paramètres étudiés avaient varié significativement entre les types d’eau usées. Les eaux usées des ateliers (DCO/DBO5>5) étaient non biodégradables tandis que les eaux usées des abattoirs et des établissements humains (DCO/DBO5<3) étaient facilement biodégradables. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur la qualité des eaux des plans d'eau de cette commune exposant les communautés aquatiques et les populations riveraines à des risques écotoxicologiques. Ainsi, ces eaux usées nécessitent un traitement préalable avant leur rejet dans la nature.
Mots clés: Eaux usées, Assainissement, Gestion, Discrimination, Porto-Novo, Bénin
Téléchargements
INTRODUCTION
La forte croissance démographique, l’industrialisation, l’intensification agricole et l’urbanisation non contrôlée s’accompagne inévitablement de la production des volumes importants des eaux usées (WWAP, 2009). Une grande partie de ces eaux usées se retourne directement dans l’environnement sans aucun traitement (WWAP, 2017). Or, ces eaux usées contiennent divers polluants tels que les résidus de produits ménagers, cosmétiques, pharmaceutiques mais aussi des matières fécales, organiques et beaucoup d’agents pathogènes (Schwarzenbach et al., 2010). Les rejets des eaux usées dans l’environnement sans aucune précaution peuvent être également source d’infections provenant des agents pathogènes tels que les coliformes, les streptocoques et Escherichia coli (Praveen et al., 2016). Les apports microbiens induisent une contamination des eaux douces et en cas de contact ou d’ingestion, ces eaux peuvent transmettre des maladies hydriques à l’Homme (Nwabor et al., 2016). En outre, les éléments nutritifs contenus dans les eaux usées provoquent un enrichissement des eaux des écosystèmes aquatiques et le développement rapide des algues (Akinnawo, 2023). La prolifération de ces algues entraîne une diminution de la quantité d’oxygène dans les eaux et peut causer la mort de certains organismes aquatiques (Chislock et al., 2013, Van Beusekom, 2018).
Malgré ces risques éco-toxicologiques, au Bénin, l’accès à l’assainissement n’est pas reluisant car les systèmes d’assainissement sont très insuffisants ou quasi inexistant dans la majorité des villes du Bénin. L’Enquête Démographique et de Santé a montré que seulement 2% des ménages béninois évacuent correctement leurs eaux usées contre 98% qui les rejettent dans la nature et dans les caniveaux (INStaD, 2013). Or, l’accès à l’assainissement est un droit humain fondamental (OMS/UNICEF, 2017). De plus, l’absence de systèmes d’assainissement sûrs est responsable de l’émergence des maladies diarrhéiques, des maladies tropicales négligées (schistosomiase, dysenteries, cysticercose, ascaridiose, filariose lymphatique, typhoïde), la propagation de la résistance aux antimicrobiens, retard de croissance (Korzeniewska et al., 2013; Amanabo-Arome et Abbas, 2021). Cela contribue également à la malnutrition, affectant négativement le développement de la petite enfance et affectant ainsi les résultats à long terme, tels que le niveau d’éducation et les revenus plus tard dans la vie (Andrés et al., 2021). Un assainissement déficient présente un risque majeur pour la santé humaine (Prüss et al., 2002) et la durabilité environnementale (UNDP, 2015).
Porto-Novo, une commune à statut particulier du Bénin n’est pas épargnée par ces problèmes d’accès à l’hygiène et à l’assainissement. En effet, Porto-Novo est à ce jour la troisième commune du Bénin du point de vue démographique (INStaD, 2016). Cette hausse démographique couplée au développement de zones non aménagées ne favorisent pas l’accès à l’assainissement aux populations. Les données disponibles montrent que l’accès à l’assainissement individuel reste insuffisant de façon générale au sein de la commune. En effet, le réseau d’assainissement de Porto-Novo avec un taux de couverture de 44% est caractérisé par des collecteurs et le manque de réseau d’assainissement collectif (PDC, 2015). Il ressort de ce qui précède que, au sein de la Commune de Porto-Novo, l’accès à l’assainissement constitue un véritable problème qui suscite des questionnements: Quel est l’état actuel de l’assainissement ? Quels sont les différents modes d’évacuation des eaux usées ? Quels sont les différents types d’équipements sanitaires utilisés pour gérer les eaux usées ? Est-ce que les eaux usées déversées dans la commune de Porto-Novo respectent-elles les normes de rejet des eaux résiduaires urbaines du Bénin ? Ainsi, la présente étude vise à examiner le système actuel de gestion des eaux usées de la commune de Porto-Novo afin d’attirer l’attention de l’opinion publique sur les conséquences potentielles de ces rejets sur l’environnement.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Milieu d’étude
L’étude s’est déroulée dans la commune de Porto-Novo. Située au sud-est du Bénin à 10 km environ de l’océan Atlantique, la ville de Porto-Novo est limitée au sud par la lagune de Porto-Novo et la commune de Sèmè-Kpodji, au nord par la commune d’Avrankou, au nord-est par la commune d’Akpro-Missérété, à l’est par la commune d’Adjara et à l’ouest par celle des Aguégués. Distante environ de 125 km de Lagos et de 175 km de Lomé, la capitale administrative du Bénin constitue l’un des maillons de la chaîne de villes située le long de l’océan Atlantique depuis Luanda en Angola jusqu’à Dakar au Sénégal. Située sur le rebord du plateau de Sakété, elle avait une population de 179.138 habitants au recensement de 1992; aujourd’hui sa population est estimée à 300.000 habitants environ.
Unités d’observation et échantillonnage
L’unité statistique enquêtée dans notre étude est le ménage. Les cinq (05) arrondissements de cette commune sont pris en compte dans la collecte de données. L’arrondissement est représenté par deux types de quartiers de ville: deux (02) quartiers de ville ayant plus de ménages et (02) deux quartiers de ville ayant moins de ménages. Cette information a été obtenue en se basant sur les données contenues dans les cahiers des villages et quartiers de ville du département de l’Ouémé (RGPH-4, 2013) (INStaD, 2016). Au total 400 ménages sont enquêtés. Pour déterminer la taille des ménages à enquêter, la formule de Fisher a été utilisée. P est la proportion de ménages supposés avoir les caractères recherchés. Ne disposant d’aucune valeur pour cette proportion, elle a été fixée à 50% (0,5). Avec un taux de confiance de 95%, une marge d’erreur de 5%, l’enquête a été portée sur 400 ménages repartis en fonction du poids de chaque quartier comme l’indique le tableau 1. Le facteur discriminant pour le choix des ménages visités a été le critère de proximité des points de stagnation des eaux usées, des collecteurs d’eaux pluviales et le type d’habitat.
Données collectées, outils et techniques de collecte
Les données ont été collectées lors des entretiens individuels non semi-structurés et informels donnant une large manœuvre aux enquêtés par usage d’un questionnaire préétabli et testé lors de la phase exploratoire. Parallèlement à ces enquêtes, des observations ont été faites sur le terrain; ce qui a permis de prendre des photographies pour illustrer certaines analyses faites. Le questionnaire adressé aux ménages comporte plusieurs parties: les infrastructures d’assainissements, le mode de gestion et les lieux d’évacuation des eaux usées.
Méthodologie d’échantillonnage des eaux usées
Les observations directes sur le terrain ont permis d’identifier les sources de pollution qui déversent directement leurs eaux usées dans l’environnement. Au niveau de chaque point de déversement des eaux usées, les informations collectées ont été relatives aux sources de rejets des eaux usées, leurs coordonnées GPS et leur localisation.
Analyses physico-chimiques des eaux usées
Au niveau de chaque point de déversement des eaux usées, la température, la conductivité et le TDS (solides totaux dissous) ont été mesurés à l’aide d’un multimètre portable (Hanna HI 99300). Le pH-mètre portable (Hanna HI 98107) a été utilisé pour la mesure du pH. Toutes ces mesures ont été effectuées in situ au point de déversement des eaux usées. De plus, les eaux usées ont été prélevées à l’aide des bouteilles de 500 ml stériles. Au niveau de chaque point de déversement des eaux usées, un échantillon composite a été réalisé à partir de trois sous-échantillons prélevés en trois points différents. Les échantillons ont été disposés puis conservés à une température de 4 ºC dans une glacière contenant de la glace afin d’assurer leur transport jusqu’au laboratoire. Les eaux usées prélevées ont été utilisées pour l’analyse des paramètres suivants: DBO5, DCO, ammonium, nitrites, nitrates et orthophosphates ont été dosés par photométrie en utilisant le spectrophotomètre Hach DR 1900 avec des réactifs pré-dosés au Laboratoire de Génie Rural de l’université Nationale d’Agriculture.
Analyses bactériologiques des eaux usées
Les échantillons ainsi recueillis ont été conservés au frais dans une glacière jusqu’à leur analyse au laboratoire après leur prélèvement. L’analyse bactériologique des eaux usées a été faite par le dénombrement des coliformes fécaux (CF), streptocoques fécaux (SF) et Escherichia coli.
Détermination du Coefficient de biodégradabilité
Le rapport DCO/DBO5 a été calculé pour estimer la biodégradabilité de la matière organique des eaux usées. Les classes suivantes (Rodier et al., 2016) ont été utilisées pour catégoriser les eaux usées: l’effluent est facilement biodégradable (DCO/DBO5 < 2); l’effluent est biodégradable avec des souches sélectionnées (2 < DCO/DBO5 < 3) et l’effluent n’est pas biodégradable (DCO/DBO5 > 3).
Analyses statistiques des données
Les statistiques descriptives sous forme de fréquences, de moyennes et leurs écarts-types ont été utilisées pour résumer les données d’enquête et d’inventaire des sources de pollution. La typologie des sources de pollution a été faite à l’aide d’une analyse en composantes principales (ACP). Les moyennes des paramètres physico-chimiques des eaux usées ont été comparées aux normes de l’OMS et du Bénin pour les eaux usées. Les paramètres physico-chimiques, bactériologiques et le ratio ont été comparés avec le test de Tukey au seuil de significativité de 5% après avoir testé la normalité. Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R4.2.2 (R Core Team, 2024).
RÉSULTATS
Modes de gestion des eaux usées dans la commune de Porto-Novo
Les eaux usées enregistrées dans la commune de Porto-Novo étaient des eaux de lessive, de vaisselle, de douche et des eaux- vannes.
Gestion des eaux de lessive et de vaisselle
Les résultats de l’enquête ont révélé quatre lieux d’évacuation des eaux de lessive et de vaisselle à savoir les rues, les cours des maisons, les puisards et les caniveaux (Tableau 2). Il en ressort que 94,0% des enquêtés jettent leurs eaux usées de lessive dans la nature (rue, cours des maisons et caniveaux) contre 6% qui les jettent dans les puisards. De même, la grande majorité des eaux de vaisselles et de cuissons soit les 91,5 % étaient déversées dans la nature (rue, cours des maisons et caniveaux) contre 8,50% qui étaient jetées dans les puisards (Tableau 2).
Gestion des eaux de douche et des eaux vannes
À Porto-Novo, les populations déversent les eaux de bains et des eaux vannes dans les fosses septiques, les puisards, les latrines, les rues et les caniveaux (Tableau 2). Les enquêtes ont révélé que les caniveaux (48,5%) et les rues (30,0%) étaient les lieux les plus utilisés pour évacuer les eaux de douche à Porto-Novo. De plus, les latrines (35,0%), les rues (29,5%) et les caniveaux (20,0%) constituaient les lieux les plus privilégiés pour l’évacuation des eaux vannes dans la commune de Porto-Novo (Tableau 2).
Structures d’assainissement utilisés pour la gestion des eaux usées
Le Tableau 3 présente les informations sur les structures d’assainissement utilisées à Porto-Novo pour la gestion des eaux usées. Il révèle que parmi les enquêtés seulement 42,5% avaient accès à une structure d’assainissement approprié contre 57,5% qui n’avaient pas accès à une structure d’assainissement adéquate (Tableau 3). Les enquêtes ont révélé que les latrines modernes (66,4%), les douches (60%) et les latrines traditionnelles (55,2%) étaient les structures d’assainissement les plus utilisées par les populations à Porto-Novo.
Sources de rejet des eaux usées dans la commune de Porto-Novo
La figure 2 présente les différentes sources productrices des eaux usées dans la commune de Porto-Novo avec leur pourcentage. Il en ressort que, les sources de rejet d’eaux usées de la commune de Porto-Novo étaient multiples. On y retrouve les eaux usées provenant des marchés, des abattoirs, des mosquées, des ateliers (mécanique, coiffure, peinture), des maisons, des hôpitaux ainsi que celles des centres de lavage des engins. Les maisons représentaient la source la plus abondante (55,8%). Les ateliers, les centres de lavage des engins et les moquées suivaient avec respectivement 21,9%, 7,64% et 6,98% de l’effectif total des sources rencontrées (Figure 2).
Typologie des eaux usées en fonction des sources de pollution
Une typologie abiotique des eaux usées réalisée à l’aide d’une analyse en composantes principales (ACP) a révélé que l’essentiel des informations contenues dans les variables étaient contrôlées à 93,3% par les deux premières dimensions (1 et 2) (Figure 3b). La dimension 1 a été expliquée par les coliformes totaux (10,9%), la conductivité (10,3%), le TDS (10,3%), E. coli (10,2%), les orthophosphates (10%), la température (8,4%) et les streptocoques fécaux (8,0%). La dimension 2 a été principalement formée par les nitrites (15,7%), les nitrates (13,3%), les coliformes fécaux (12,47%), la DCO (12,0%), la DBO5 (10,0%) et l’ammonium (9,2%). Les centres de lavage (30,8%) et les ateliers (15,2%) avaient contribué fortement à la formation de la dimension 1 alors que les abattoirs (70,1%) avaient participé fortement à la formation de la dimension 2.
Les coliformes totaux (r=0,98; p=0,00), les streptocoques fécaux (r=0,84; p=0,02) et E. coli (r=0,95; p=0,00) étaient significativement, fortement et positivement corrélés à la dimension 1 alors que la température (r= -0,86; p=0,01), les orthophosphates (r= -0,93; p=0,00), la conductivité et le TDS (r= -0,97; p=0,00) étaient fortement, négativement et significativement corrélés à la dimension 1 (Figure 3a). La DCO (r=0,85; p=0,01), la DBO5 (r=0,78; p=0,03) étaient significativement, fortement et positivement corrélés à la dimension 2 tandis que les coliformes fécaux (r= -0,87; p=0,01), les nitrates (r= -0,98; p=0,00) et les nitrites (r= - 0,90; p=0,00) étaient significativement, fortement corrélés à la dimension 2 (Figure 3a).
La projection des paramètres physico-chimiques et des sources de pollution dans le système des deux premiers axes de l’ACP avait indiqué trois groupes d’eaux usées (Figure 3b). Le premier groupe était composé des eaux usées issues des abattoirs. Le deuxième groupe était composé des eaux usées provenant des ateliers de mécaniques, de peinture et des centres de lavage des motos puis voiture. Le troisième groupe était celui des eaux usées issues des mosquées, des marchés et des habitations (Figure 3b). Les eaux usées de cette troisième catégorie étaient rassemblées sur la terminologie d’eaux usées domestiques (établissements humains).
Caractéristiques physico-chimiques des eaux usées étudiées
Les valeurs de conductivité, de TDS, de la DBO5, d’oxygène dissous, de la DCO, de NO2-, de PO43- et la température des eaux usées avaient varié significativement entre les sources de pollution (p < 0,05) (Tableau 4). Alors que, les valeurs de pH, de NH4+ et de NO2- des eaux usées n’avaient pas varié significativement entre les sources de pollutions (p > 0,05) (Tableau 4). En effet, les valeurs de conductivité, de TDS et des orthophosphates des eaux usées des ateliers étaient significativement supérieures à celles des abattoirs et des établissements humains qui étaient similaires (Tableau 4). Les valeurs de la DCO et de la DBO5 des eaux usées des ateliers et des établissements humains abattoirs étaient significativement supérieurs à celles des abattoirs (Tableau 4). Les valeurs d’oxygène dissous et de NO2- des eaux usées des abattoirs étaient significativement supérieures à celles des ateliers et des établissements humains (Tableau 4). Les valeurs de la température des eaux usées des ateliers et des abattoirs étaient significativement supérieures à celles des établissements humains (Tableau 4).
Caractéristiques bactériologiques des eaux usées étudiées
Les concentrations des eaux usées en coliformes totaux n’avaient pas significativement variés entre les sources de pollution (p > 0,05) tandis que, les concentrations des eaux usées en coliformes fécaux, en streptocoques fécaux et en E. coli avaient varié significativement entre les sources de pollution (p < 0,05) (Tableau 5). Les concentrations en coliformes fécaux, en streptocoques fécaux et en E. coli des eaux usées des ateliers étaient inférieures à celles des eaux usées des établissements humains et des abattoirs (Tableau 5).
Évaluation de la biodégradabilité des eaux usées étudiées
La Figure 4 présente les variations du coefficient de biodégradabilité des eaux usées en fonction des sources de pollution. L’indice de biodégradabilité des eaux usées avait varié significativement entre les sources de pollutions (F = 46,0; p < 0,001). Le ratio DCO/DBO5 des eaux usées des ateliers (6,1 ± 1,32) était significativement supérieur aux ratios des eaux usées des abattoirs (2,62 ± 0,26) et des établissements humains (2,24 ± 0,67) qui étaient similaires. De plus, le ratio DCO/DBO5 des eaux usées des ateliers était supérieur à 5 alors que les ratios des eaux usées des abattoirs et établissements humains étaient inférieurs à 3 (Figure 4). Ainsi, les eaux usées des ateliers étaient non biodégradables tandis que les eaux usées des abattoirs et des établissements humains étaient facilement biodégradables.
DISCUSSION
Modes de gestion des eaux usées dans la commune de Porto-Novo
À Porto-Novo, la majorité de la population, plus de 78% déversaient les eaux usées dans la nature (rue, cours des maisons et caniveaux). Ces résultats sont inférieurs aux résultats de Enquête Démographique et de Santé (EDSB-IV 2011-2012), selon lesquels seulement 2% des ménages béninois évacuent correctement leurs eaux usées contre 98% qui les rejettent dans la nature et dans les caniveaux (INStaD, 2013). Cette diminution montre que beaucoup d’efforts sont faits pour remédier à ce problème à travers le lancement d’un plan directeur de l’assainissement en 2015 et les actions politiques d’assainissement du cadre de vie par le gouvernement du Bénin prévus par le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2021-2026).
Les rejets d’eaux usées dans la nature (rue, cours des maisons et caniveaux) observés dans la commune de Porto-Novo seraient liés au déficit d’infrastructures conventionnelles d’assainissement dans le processus d’urbanisation qui laisse libre cours à la population dans le choix de ses méthodes d’évacuation des eaux usées. Le caractère approximatif des modes de gestion individuelle et de rejet incontrôlé des eaux usées constitue un facteur de risque important de santé publique, notamment les groupes les plus fragiles, mais également impacte négativement sur le cadre de vie et l’écosystème naturel (Awofeso et al., 2013; Zerbo et al., 2021). Cette situation est d’autant plus préoccupante que ce taux de desserte en assainissement urbain régresse au fil du temps avec le développement des villes où les établissements humains précèdent presque toujours la mise en place des infrastructures (Bechi, 2013).
Structures d’assainissement utilisés pour la gestion des eaux usées
A Porto-Novo, seulement 42,5% des ménages enquêtés avaient accès à un système d’assainissement approprié. Ce pourcentage est supérieur à la proportion de la population béninoise de 2015 qui avaient eu accès aux installations sanitaires qui est de 17% (OMS et UNICEF, 2015). Mais cette proportion est inférieure aux prévisions pour les populations sahéliennes qui est de 62% d’accès à l’assainissement prévu dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMS et UNICEF, 2015). Cela représente un déficit de 20% pour le Bénin en matière d’assainissement. Compte tenu des déficits (20% pour le Bénin en matière d’assainissement) par rapport aux cibles fixées, il est tout à fait évident qu’une proportion importante de la population béninoise utilise des installations sanitaires non améliorées. Ce qui justifie le pourcentage 42,5% observé à Porto-Novo et constitue un grand défi pour la réalisation de la cible des ODD en matière d’assainissement. Les latrines (modernes et traditionnelles) en plus des douches étaient les structures d’assainissement les plus utilisés par les populations à Porto-Novo. La forte présence des latrines et des douches dont les caractéristiques techniques s’éloignent des normes urbanistiques prescrites indiquent que les populations ont le souci d’assainir leur cadre de vie mais seraient limitées. En général, les ménages les plus riches sont ceux qui utilisent davantage de toilettes à chasse d’eau, par rapport à leurs homologues les plus pauvres qui utilisent principalement des installations sanitaires non améliorées ou pratiquent la défécation à l’air libre. Dans la commune d’ Abomey-Calavi, Yamontche et al. (2020) ont observé en notifiant que l’absence des structures d’assainissement dans certains ménages n’est pas liée à des contraintes culturelles et cultuelles, mais elle est plus en relation avec la pauvreté et la disponibilité d’espace non bâti. Ces observations corroborent ceux de Biswas et al. (2024) et Hlongwa et al. (2024) qui ont souligné de fortes disparités dans l’accès à un assainissement amélioré entre les riches et les pauvres, tant en milieu urbain que rural, dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne.
Sources de rejet des eaux usées dans la commune de Porto-Novo
Les maisons (55,8%) représentent la source la plus prépondérante de production des eaux usées dans la commune de Porto-Novo. Les ateliers et les centres de lavage des engins, les mosquées suivent alors que les marchés, les abattoirs et les hôpitaux représentent les sources les moins abondantes de l’effectif total des sources de pollution rencontrées. Les différentes sources de rejet des eaux usées retrouvées sont similaires aux observations de Agossou et al. (2014) dans la commune de Parakou. L’abondance des eaux usées domestiques obtenue dans cette étude est conforme à l’observation de Abahi (2022) qui a trouvé 57,3% pour les eaux usées domestiques. La prépondérance des eaux usées domestiques observée serait due à l’urbanisation accrue de la ville de Porto-Novo car selon Sheng et al. (2020) l’urbanisation impacte fortement les émissions des eaux usées domestiques.
Caractéristiques physico-chimiques des eaux usées de Porto-Novo
Dans cette étude, les valeurs de pH mesurées avaient oscillé entre 4,3 et 8,7 et étaient autour de 7,1 en moyenne. La neutralité du pH a été observée au niveau de tous les points de prélèvements. Les valeurs obtenues étaient inférieures à celles trouvées (7,7- 8,2) par Yovo et al. (2017) pour les eaux usées de Agla (Cotonou) et respectent les normes de l’OMS (OMS, 2013) et nationales (Décret, 2001) de rejets fixées à une valeur variant entre 6 et 9. Les températures enregistrées sont comprises entre 22 °C et 31 °C. Les valeurs de température obtenues quelle que soient les sources sont inférieures à celles trouvées (29,0 à 33,4 °C) par Adjahouinou et al. (2014) mais elles sont supérieures aux valeurs rapportées par Yovo et al. (2017). Les valeurs moyennes des différentes sources de pollution étaient situées dans la fourchette des valeurs de températures recommandées pour les rejets des eaux usées au Bénin (30 °C) (Décret, 2001) dans la réglementation béninoise. Puisque, la norme recommande des températures maximales supérieures à 1 º C à la température des eaux réceptrices, qui sont ici des rivières tropicales dont les températures varient souvent entre 20 ° C et 30 ° C tout au long de l’année (Latrubesse et al., 2005). Les valeurs de la conductivité ont varié de 139 à 1675 µS/cm alors que les valeurs de TDS ont varié de 70 à 838 mg/L. Les fortes valeurs de la conductivité et des TDS observées sur tous les sites de prélèvement indiquent la présence de la matière organique et une forte minéralisation des eaux usées résultant de la forte activité microbienne de décomposition de la matière organique (Gerardi, 2006). Les valeurs de conductivité et de TDS obtenues dans cette étude sont inférieures aux valeurs des eaux usées rapportées par Yovo et al. (2017) et par Adjahouinou et al. (2014). Les concentrations des nitrates (NO3-) avaient varié entre 0,00 mg/l et 102 mg/l. Les fortes valeurs de nitrates ont été observées au niveau des eaux usées des abattoirs. Ces fortes concentrations de nitrates observées seraient dues au fait que les eaux usées des abattoirs contiennent des nitrates provenant des déchets animaux, de l’alimentation des animaux, des produits chimiques de nettoyage et de traitement proviennent, qui constituent une source importante d’apports de nitrates (Serio et al., 2018; Velusamy et al., 2021). Par ailleurs, les différentes sources de pollution avaient enregistré des valeurs supérieures à 25 mg/L. Ceci montre que les sources de nitrates sont multiples et confirment les observations de Shukla et Saxena (2018) et Singh et al. (2022) selon lesquelles, les différentes sources anthropiques de contamination par les nitrates comprennent les engrais, les utilisations industrielles des nitrates, les déchets animaux et humains, la déforestation, l’aménagement paysager, etc.
La teneur en nitrites avait fluctué entre 0,00 mg/L et 5,52 mg/L. Les fortes valeurs de nitrites avaient été observées au niveau des eaux usées des abattoirs. Une comparaison des différentes concentrations de nitrites avec l’échelle de Dagot et Laurent (2014) permet de constater que les valeurs obtenues sont largement supérieures aux valeurs limites. Alors que l’exposition aux nitrites affecte négativement la croissance des poissons et des crustacés, la mue, la capacité de transport d’oxygène dans le sang, l’équilibre hydrique, l’osmorégulation, l’homéostasie ionique et provoque des perturbations endocriniennes (Ciji et Akhtar, 2020). Par conséquent, le rejet de ces eaux usées dans les rivières causerait de graves conséquences écologiques.
La teneur en orthophosphates des eaux usées avait oscillé entre 0,05 mg/L et 55 mg/L. Les fortes valeurs d’orthophosphates avaient été enregistrées au niveau des eaux usées des ateliers et des établissements humains. Les fortes valeurs d’orthophosphates obtenues au niveau des eaux usées des ateliers et des établissements humains pourraient être dues aux déchets du métabolisme humain (urines et fèces), détergents ménagers ajoutés aux eaux de lavage (linge et vaisselle), déchets (hors détergents) collectés avec les eaux de cuisine (lavage de la vaisselle, déchets alimentaires liquides) et les eaux de lavage riches en phosphates; qui caractérisent ces sources de pollution (Stricker et Heduit, 2010). Il a été démontré que les orthophosphates augmentent la production de micro-organismes aquatiques photosynthétiques mais leur concentration doit être inférieure à 50 μg/L (0,05 mg/L) pour éviter l’eutrophisation (Velusamy et al., 2021). Les fortes valeurs d’ammonium avaient été enregistrées au niveau des eaux usées des ateliers et des établissements humains. Les concentrations obtenues étaient très élevées par rapport à la norme de l’OMS qui est de 0,2 mg/L. Or, les niveaux élevés d’ammonium dans les écosystèmes d’eau douce entraîne l’eutrophisation et des effets nocifs sur les organismes aquatiques (Finlay et al., 2013). Les valeurs de la DBO5 variaient de 17 à 436 mg/L et les plus fortes valeurs avaient été notées au niveau des eaux usées des ateliers et des établissements humains. Quant à la DCO, elle variait de 70 à 624 mg/L et les eaux usées des ateliers et des établissements humains présentaient les plus fortes charges organiques en DCO. Comparées aux normes nationales de rejet des eaux usées (30 mg/L ≤ DBO5 ≤ 100 mg/L et 125 mg/L ≤ DCO ≤ 300 mg/L), les charges de DBO5 et de DCO des eaux usées de Porto-Novo dépassaient les normes de rejet des eaux résiduaires du Bénin (Décret, 2001). Les mêmes observations avaient été faites par Yovo et al. (2017) et Atinkpahoun (2018) à Cotonou. L’oxygène dissous des différentes sources d’eaux usées étudiées varient entre 3 et 16,2 mg/L. Les fortes valeurs d’oxygène dissous étaient enregistrées au niveau des eaux usées des abattoirs. La concentration élevée en oxygène dissous favorise le développement des micro-organismes aérobies qui dégradent la matière organique, à l’inverse sa faible concentration favorise le développement des micro-organismes pathogènes en particulier les bactéries anaérobies (Gupta et Gupta, 2021).
Caractéristiques bactériologiques des eaux usées de Porto-Novo
La présence des indicateurs bactériens (E. coli, streptocoques fécaux, coliformes fécaux) dans les eaux usées étudiées dénote de la présence d’une charge fécale récente (Gerardi, 2006). La concentration bactériologique des eaux usées de la commune de Porto-Novo était largement supérieure à la valeur recommandée par l’OMS qui est de 1000 UFC/100 mL (OMS, 2013). Ces observations sont similaires aux observations de Yovo et al. (2017) pour les eaux usées des quartiers déshérités de Cotonou. Les fortes concentrations microbiologiques observées au niveau des eaux usées des abattoirs et des établissements humains seraient dus à l’inexistence des ouvrages d’assainissement (fosses septiques, latrines toilettes, stations d’épuration), aux rejets des déchets d’abattoirs à l’air libre, aux raccordements des eaux vannes vers les collecteurs d’eaux pluviales où elles se mélangent souvent aux eaux pluviales. Ces observations corroborent celles de Agossou et al. (2014), qui avaient fait les mêmes observations en étudiant les risques de fièvres typhoïdes et paratyphoïdes liés à l’utilisation des eaux usées en agriculture urbaine et périurbaine. Mais les eaux usées provenant des ateliers de mécanique, de peinture et des centres de lavage des véhicules avaient enregistré les faibles concentrations bactériologiques. Cette différence pourrait être dû au fait que ces eaux sont industrielles et ne contiennent pas beaucoup des matières fécales.
Biodégradabilité des eaux usées de la commune de Porto-Novo
Les eaux usées de la commune de Porto-Novo avaient un ratio DCO/DBO5 variant entre 1,20 et 8,94. Le ratio des eaux usées des abattoirs et des établissements humains était inférieur à 3. Ces eaux usées étaient alors facilement biodégradables selon les conclusions de Dagot et Laurent (2014). La moyenne du ratio DCO/DBO5 des eaux usées des établissements humains obtenue dans cette étude (2,24 ± 0,67) était proche de celui rapporté par Atinkpahoun (2018) à Cotonou qui était de 2,6. Il reste cependant supérieur à celui rapporté par Abahi (2022) qui était égale 1,47 ± 0,19 dans le bassin de l’Ouémé au Bénin. La faible valeur du ratio DCO/DBO5 enregistrée au niveau des eaux usées des abattoirs et des établissements humains pourrait être dû au fait que ces eaux comportent majoritairement les déchets alimentaires, l’urine et les matières fécales. Ces observations corroborent les observations de Abahi (2022), qui avait constaté que les eaux usées domestiques étaient facilement biodégradables. Le ratio DCO/DBO5 des eaux usées des ateliers (6,06 ± 1,32) était supérieur à 5, les mettant ainsi dans la catégorie des eaux usées non biodégradables. Ces observations étaient similaires aux observation de Abahi (2022) qui avait observé un ratio DCO/DBO5 égale à 8,70 ± 0,21 au niveau des eaux usées industrielles. La valeur du ratio DCO/DBO5 supérieure à 5 obtenue au niveau des eaux usées des ateliers serait due au fait que ces eaux contiennent des déchets organiques, des produits pétroliers, des huiles issus du fonctionnement des machines, de réparation et de lavage des engins qui sont peu biodégradables (Thomas et Thomas, 2022).
CONCLUSION
En somme, l’étude avait révélé que les maisons représentent la source de rejet des eaux usées la plus abondante à Porto-Novo. Seulement 42,5% des ménages avaient accès à une structure d’assainissement approprié et 78% des ménages déversaient les eaux usées dans la nature (rue, cours des maisons et caniveaux). Les latrines et les douches étaient les équipements d’assainissement plus utilisés. Les eaux usées de Porto-Novo véhiculaient d’importantes charges organique et bactériologique, qui dépassent les normes de rejet prescrites par l’OMS et le Bénin. Les eaux usées des abattoirs et des établissements humains étaient facilement biodégradables alors que les eaux usées des ateliers n’étaient pas biodégradables. La précarité dans le mode de gestion des eaux usées et le faible niveau d’assainissement observés dans la Commune de Porto-Novo constituent sans nul doute, une menace pour la santé des populations riveraines étant donné que des taux élevés de bactéries intestinales pathogènes y ont été détectés. Des études futures doivent s’orienter sur les déterminants et les inégalités dans l’accès à l’assainissement améliorés à Porto-Novo en intégrant des variables socio-économiques.
RÉFÉRENCES
Abahi K.S. (2022). Impact des eaux usées urbaines sur les macroinvertébrés benthiques du bassin de l’Ouémé supérieur au Bénin. Thèse présentée pour l’obtention du grade de docteur en sciences agronomiques, École Doctorale des Sciences Agronomiques et Eau, Université de Parakou, Bénin. 210 p.
Adjahouinou D.C., Yehouenou B., Liady M.N., Fiogbe E.D. (2014). Caractérisation bactériologique des eaux résiduaires brutes de la ville de Cotonou (Bénin). Journal of Applied Biosciences, 78: 6705–6713.
Agossou J., Afouda L., Adédémy J.D., Noudamadjo A., N’da Tido C., Ahohoui E.S., Tovihoudji P., Mazou F., Fayomi B., Akpona S. (2014). Risques de fièvres typhoïdes et paratyphoïdes liés à l’utilisation des eaux usées en agriculture urbaine et périurbaine: cas du maraîchage dans la ville de Parakou (Bénin). Environnement, Risques et Santé, 13: 405–416.
Akinnawo S.O. (2023). Eutrophication: Causes, consequences, physical, chemical and biological techniques for mitigation strategies. Environmental Challenges, 12: 100733.
Amanabo-Arome U.H., Abbas A.M. (2021). Environmental and health implications of poor sanitation in Nigeria. Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences, 9: 101–104.
Andrés L., Joseph G., Rana S. (2021). The Economic and Health Impacts of Inadequate Sanitation, in: Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science. Oxford University Press, Oxford.
Atinkpahoun N.C.H. (2018). Relations entre la variabilité de la pollution des eaux usées urbaines et les contextes géographiques, socio-économiques et culturels au Bénin et en France. Thèse de doctorat pour l’obtention du Grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi et docteur de l’Université de Lorraine.276 p.
Awofeso N., Kwa B., Peckham S. (2013). Water, Sanitation, and Public Health. Journal of environmental and public health, 2013: 641749, 2p.
Bechi G.F. (2013). La gestion des eaux usées dans les villes forestières ivoiriennes: des risques de marginalité. Revue de Géographie du Laboratoire Leïdi, 11: 1–18.
Biswas S., Adhikary M., Alam A., Islam N., Roy R. (2024). Disparities in access to water, sanitation, and hygiene (WASH) services and the status of SDG-6 implementation across districts and states in India. Heliyon 10: 1-17.
Chislock M.F., Doster E., Zitomer R.A., Wilson A.E. (2013). Eutrophication: causes, consequences, and controls in aquatic ecosystems. Nature Education Knowledge, 4: 1-8.
Ciji A., Akhtar M.S. (2020). Nitrite implications and its management strategies in aquaculture: a review. Reviews in Aquaculture, 12: 878–908.
Dagot C., Laurent J. (2014). Module d’enseignement ASTEP. Traitement des eaux usées urbaines. UVED. Limoges-France. 151 p.
Décret (2001). Décret no 2001/109 du 4 avril 2001 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en République du Bénin.17 p.
Finlay J.C., Small G.E., Sterner R.W. (2013). Human influences on nitrogen removal in lakes. Science, 342: 247–250.
Gerardi M.H. (2006). Wastewater Microorganisms, in: Wastewater Bacteria. John Wiley & Sons, Ltd, pp. 1–10.
Gupta R., Gupta N. (2021). Bacterial response to oxygen availability, in: Gupta, R., Gupta, N. (Eds.), Fundamentals of Bacterial Physiology and Metabolism. Springer Singapore, Singapore, pp. 575–592.
Hlongwa N., Nkomo S.L., Desai S.A. (2024). Barriers to water, sanitation, and hygiene in Sub-Saharan Africa: a mini review. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, 14: 497–510.
INStaD (2013). Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2011-2012. Calverton, Maryland, USA: INSAE et ICF International, 573 pages.
INStaD (2016). Effectifs de la population des villages et quartiers de ville du Bénin (RGPH-4, 2013), 85 pages.
Korzeniewska E., Korzeniewska A., Harnisz M. (2013). Antibiotic resistant Escherichia coli in hospital and municipal sewage and their emission to the environment. Ecotoxicology and environmental safety, 91: 96–102.
Latrubesse E.M., Stevaux J.C., Sinha R. (2005). Tropical rivers. Geomorphology, 70: 187–206.
Nwabor O.F., Nnamonu E.I., Martins P.E., Ani O.C. (2016). Water and waterborne diseases: a review. International Journal of Tropical Disease and Health, 12: 1–14.
OMS (2013). Directives OMS pour l’utilisation sans risques des eaux usées, des excrétas et des eaux ménagères. Volume I: Considérations d’ordre politique et réglementaire.128 p.
OMS/UNICEF (2015). Progress on sanitation and drinking water: 2015 update and MDG assessment. World Health Organization. 90 p.
OMS/UNICEF (2017). Progress on drinking water, sanitation and hygiene, update and SDG baselines. Geneva. 116 p.
PDC (2015). Plan de Développement Communal de la ville de Porto-Novo. 67 pages.
Praveen P.K., Ganguly S., Wakchaure R., Para P.A., Mahajan T., Qadri K., Kamble S., Sharma R., Shekhar S., Dalai N. (2016). Water-borne diseases and its effect on domestic animals and human health: A Review. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 6: 242–245.
Preisner M., Neverova-Dziopak E., Kowalewski Z. (2020). Analysis of eutrophication potential of municipal wastewater. Water Science and Technology, 81: 1994–2003.
Prüss A., Kay D., Fewtrell L., Bartram J. (2002). Estimating the burden of disease from water, sanitation, and hygiene at a global level. Environmental Health Perspectives, 110: 537–542.
R Core Team (2024). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
Rodier J., Legube B., Merlet N. (2016). L’analyse de l’eau: contrôle et interprétation, Dunod, Paris. 1526 p.
Schwarzenbach R.P., Egli T., Hofstetter T.B., Von Gunten U., Wehrli B. (2010). Global water pollution and human health. Annual review of environment and resources, 35: 109–136.
Serio F., Miglietta P.P., Lamastra L., Ficocelli S., Intini F., De Leo F., De Donno A. (2018). Groundwater nitrate contamination and agricultural land use: A grey water footprint perspective in Southern Apulia Region (Italy). Science of The Total Environment, 645: 1425–1431.
Sheng P., Zhai M., Zhang Y., Kamal M.A. (2020). The effects of urbanization on household wastewater emissions in China: efficient-and inefficient-emissions. Environmental Pollution, 267: 115350, 8p.
Shukla S., Saxena A. (2018). Global status of nitrate contamination in groundwater: its occurrence, health impacts, and mitigation measures, in: Hussain, C.M. (Ed.), Handbook of Environmental Materials Management. Springer International Publishing.
Singh S., Anil A.G., Kumar V., Kapoor D., Subramanian S., Singh J., Ramamurthy P.C. (2022). Nitrates in the environment: A critical review of their distribution, sensing techniques, ecological effects and remediation. Chemosphere, 287: 131996.
Stricker A.E., Heduit A. (2010). Phosphore des eaux usées: état des lieux et perspectives (rapport). IRSTEA. 54 p.
Thomas O., Thomas M.-F. (2022). Chapter 12 - Industrial wastewater, in: Thomas, O., Burgess, C. (Eds.), UV-Visible Spectrophotometry of Waters and Soils (Third Edition). Elsevier, pp. 385–416.
UNDP (2015). Human development report 2014: Sustaining human progress: Reducing vulnerabilities and building resilience. 239 p.
Van Beusekom J.E.E. (2018). Eutrophication, in: Salomon, M., Markus, T. (Eds.), Handbook on Marine Environment Protection. Springer International Publishing. pp. 429–445.
Velusamy K., Periyasamy S., Kumar P.S., Vo D.-V.N., Sindhu J., Sneka D., Subhashini B. (2021). Advanced techniques to remove phosphates and nitrates from waters: a review. A review. Environmental Chemistry Letters, 19: 3165–3180.
WWAP (2009). The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World. Paris: UNESCO, and London: Earthscan. 429 p.
WWAP (2017). Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2017: Les eaux usées: une ressource inexploitée. Paris, UNESCO. 204 p.
Yamontche S., Roch Christian J., Gouissi F., Gratien B., Degbey C., Houssou C. (2020). État des lieux et facteurs associés en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans la commune d’Abomey-Calavi Au Bénin. European Scientific Journal, 16: 524- 540.
Yovo F., Dimon B., Yayi E., Suanon F., Agani I., Wotto V., Sohounhloue D., Eni C.A. (2017). Caractérisation d’eaux usées des quartiers déshérités du sud du Bénin: cas du quartier Agla. Déchets Sciences et Techniques, 74: 1–7.
Zerbo A., Delgado R.C., González P.A. (2021). Water sanitation and hygiene in Sub-Saharan Africa: Coverage, risks of diarrheal diseases, and urbanization. Journal of Biosafety and Biosecurity, 3: 41–45.

Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Fondé(e) sur une œuvre à www.agrimaroc.org.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à www.agrimaroc.org.