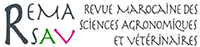Impact d’une supplémentation en fourrage vert de luzerne et de pois d’angole sur les performances pondérales des chèvres et chevreaux
DOI :
https://doi.org/10.5281/zenodo.16748618Mots-clés :
Chèvre rousse, Luzerne, Pois d’angole, Supplémentation, performances zootechniques, Elevage extensif, NigerRésumé
L’alimentation animale est l’une des contraintes les plus cruciales des systèmes d’élevage au Niger. L’objectif principal de cette étude est d’analyser l’usage du fourrage vert de luzerne et du pois d’angole, comme alternative à la supplémentation animale. Six chèvres suitées avec neuf petits ont été réparties en un lot expérimental et un second lot témoin avec 3 femelles chacun. Le lot témoin, avec 5 chevreaux, a été alimenté par une ration composée de fane d’arachide, de son de blé et de tourteau de coton, tandis que le lot expérimental qui avait 4 chevreaux a bénéficié, en plus de la ration de base, d’une supplémentation en fourrage vert de luzerne et de pois d’angole. Les résultats montrent que les gains moyens en performances pondérales des chevreaux ont été significativement plus importants pour le lot expérimental comparé au témoin, avec respectivement 8,2 et 7,0 kg pour le poids corporel. L’analyse en composante principale mettant en relation l’évolution des quantités des ingrédients de la ration supplémentée et celle des paramètres biométriques, montre que, plus l’apport en quantité de luzerne et de pois d’angole dans le rationnement augmente, plus les animaux concernés gagnaient en indices corporels biométriques. Il est aussi observé une influence non significative de la supplémentation sur la relation barymétrique entre le poids corporel et le tour de poitrine des chevreaux. Les résultats de cette étude indiquent que ces deux légumineuses pourraient bien servir de supplémentations des chèvres suitées des systèmes d’élevage caprin du Niger.
Mots clés: Chèvre rousse, Luzerne, Pois d’angole, Supplémentation, performances zootechniques, Élevage extensif, Niger
Téléchargements
INTRODUCTION
En Afrique, la zone sahélienne constitue une des principales régions d’élevage par excellence. En effet, son bétail était estimé à 37 millions de têtes d’animaux en 2017, soit 37,6% de l’effectif total du cheptel africain (FAO, 2017).
Du fait de sa position géographique et de son climat sahélien sur plus des 2/3 de son territoire, le Niger est un pays agropastoral où l’élevage constitue l’une des plus importantes richesses en première ligne aux côtés des ressources minières. Le Niger est par excellence un pays d’élevage du fait de l’importance et de la diversité de son cheptel estimé en 2017 à 46.484.801 têtes de ruminants et un potentiel physique impressionnant de 60 millions d’hectares pâturables (CIRAD, 2018). Au Niger, l’élevage est une activité génératrice de revenu qui contribue à consolider les moyens d’existence des populations, surtout rurales. L’élevage des petits ruminants occupe une place importante dans l’économie des ménages et ceci plus particulièrement auprès de ceux en zone sahélienne (Maman Lawal et al., 2018). Cet élevage se focalise sur deux espèces, notamment les caprins et les ovins (Maman Lawal et al., 2018).
Parmi les petits ruminants, les caprins sont rencontrés dans toutes les zones climatiques du Niger et son élevage concerne toute la population aussi bien sédentaire que nomade (Adam et al., 2019). L’élevage des caprins contribue à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration significative de l’alimentation des populations (FAO, 2013a). Ils sont représentés par la chèvre du Sahel et la chèvre rousse de Maradi. La chèvre rousse de Maradi est une race qui attire l’attention pour ses multiples qualités liées à ses performances de reproduction et de production laitière (Helliot et al., 2021; Adjassin et al., 2022).
Cependant au Niger, les animaux sont confrontés à une sous-alimentation chronique, affectant toutes les productions (Aziada et al., 2021). Chez les caprins, les jeunes en croissance, les animaux âgés et les femelles gestantes sont les plus vulnérables. On assiste alors à des avortements, des mortalités prénatales et des dystocies par épuisement, des abattages et ventes involontaires. Néanmoins, des initiatives importantes locales sont souvent menées en vue d’augmenter le disponible alimentaire pour les animaux (Soumana et al., 2016; Malam-Abdou et al., 2017; Mouctari et al., 2017; Barazi et al., 2019). Plusieurs ingrédients ont été aussi testés comme suppléments protéiques (Elhadji-Nouhou, 2014; Malam-Abdou et al., 2017; Akourki et al., 2019).
Par ailleurs, il existe peu de données traitant l’alimentation de la chèvre allaitante permettant d'appréhender l’impact indirect du régime supplémenté sur les performances de croissance des chevreaux avant leur sevrage.
L’objectif de cette étude est d’analyser l’impact de l’utilisation du fourrage vert de luzerne et du pois d’angole dans l’alimentation des chèvres allaitantes, sur les pondérales des chevreaux roux de Maradi avant sevrage.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Site expérimental
L’essai s’est déroulé à la ferme caprine du site polyvalent d’expérimentations de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université Djibo Hamani de Tahoua. Le site couvre une superficie de 6,5 hectares. Il est situé à 2 km au sud-ouest de l’Université de Tahoua, à 14°15’13’’ de latitude Nord et 5°16’16’’ de longitude Est sur une altitude de 381 m (Figure 1). Le climat de la zone est de type sahélien caractérisé par une saison sèche allant d’octobre à mai et une saison pluvieuse allant de juin à septembre. Les précipitations sont irrégulières d’une année à l’autre avec un cumul moyen annuel de 393,5 mm reparti en 35 jours. La température moyenne annuelle de la région s’élève à 29°C, avec respectivement un minimal et un maximal de 16°C et 45°C.
Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental comprend six chèvres suitées avec neuf petits qui ont été répartis en un lot expérimental et un second lot témoin avec 3 femelles chacun. Le lot témoin, avec 5 chevreaux, a été alimenté par une ration composée de fane d’arachide, de son de blé et de tourteau de coton, tandis que le lot expérimental qui avait 4 chevreaux a bénéficié, en plus de la ration de base, d’une supplémentation en fourrage vert de luzerne et de pois d’angole. Tous les animaux ont été identifiés à l’aide de boucles d’oreilles en plastique numérotés. L’âge des mères a été déterminé au début de l’expérimentation en utilisant le formulaire de dentition rapporté par la FAO (2013b) en considérant que chez l’espèce caprine, l’animal atteint l’âge adulte à partir de quatre paires d’incisives adultes (Bouchel et al., 2006). Le poids à la naissance des chevreaux a été déterminé et celui de leur mère après mise bas. Ils sont maintenus en stabulation libre et repartie en deux lots. Chaque lot est installé dans un espace (bloc vital) de 4,5 m x 5,5 m soit une superficie 24,75 m². Les animaux étaient repartis de façon aléatoire dans les blocs de sorte que chaque lot contient 3 chèvres avec leurs petits (chevreaux). Le suivi des animaux pour la collecte effective des données a été conduit pendant 12 semaines (84 jours).
Rationnement
Les deux lots, expérimental et témoin, ont été mis chacun dans un bloc qui contient deux mangeoires (une pour les fourrages et l’autre pour les concentrés) et un abreuvoir. La ration de base est la même pour tous les deux lots (Tableau 1). Elle est constituée de la fane d’arachide du son de blé et du tourteau de coton, offerte en deux repas; l’un est donné la matinée entre 8 h - 9 h et le second est donné dans l’après-midi entre 17 et 18 h. La supplémentation en fourrage vert de luzerne et du pois d’angole est effectuée en un seul repas dans la matinée. Le fourrage vert de luzerne et du pois d’angole est fauché pour donner aux mères du lot expérimental après avoir offert l’aliment de base. Les quantités d’aliments distribuées était pesées et le rationnement était ajusté pour éviter les rejets. Ainsi, les aliments ont été apportés en quantité suffisante. Chaque matin avant le service, il y a un contrôle des refus. En cas de refus, celui-ci a été collecté et pesé à l’aide d’un peson d’une portée de 10 kg avec précision de 1 g, ensuite enregistré sur une fiche élaborée à cet effet. En ce qui concerne l’abreuvement, l’eau potable est donnée à volonté chaque jour et de la pierre à lécher a été donnée tous les deux jours.
Collectes des données
Les chevreaux du lot expérimental et du lot témoin ont été pesés toutes les semaines et leurs mères ont été pesées toutes les deux semaines à l’aide d’un peson électronique de portée 50 kg et de sensibilité de 10 g. Tous les chevreaux ont été pesés dès leur naissance, et les mères 24 h après leur mise-bas. Ces animaux sont pesés à jeûne le matin avant la distribution de la ration. Ensuite, trois mesures morphologiques ont été prises sur des parties anatomiques précises de chaque chevreau pour décrire la hauteur au garrot, la longueur du corps et le tour de la poitrine. Ces mesures morpho-biométriques hebdomadaires ont été prises à l’aide d’un mètre ruban. L’état corporel des chevreaux et des mères a été évalué par observation visuelle et par palpation, sur une échelle de notation à six points (Eric, 2020). A partir des données ainsi mesuré, les indices suivants ont été calculés:
Indice de consommation (IC): c’est le critère utilisé pour mesurer l’efficacité de la conversion d’un aliment en une production donnée. Il a été calculé pour les chèvres (mères) par le rapport de la quantité d’aliment consommée pendant une période sur le gain en poids moyen durant la période.
IC= Quantité d’aliment ingéré/croit pondéral de l’animal
Pour l’ensemble des mesures morpho-biométriques destinées à évaluer les performances pondérales des chevreaux (Poids, HG, LC, et TP), le Gain Moyen Quotidien (GMQ) a été calculé comme suit:
GMQ= Performance à la fin – Performance en début / nombre de jours de la période
Analyses statistiques
Les données sur les performances pondérales ont été soumises à une analyse de variances à l’aide d’un modèle à effets mixtes (pour données longitudinales). L’équation générale du modèle s’écrit:
Yijkl = µ + Age i + Sexe j + Traitement k + Sexe i * Traitement k + eijkl
Où Yijkl est la performance ‘l’ d’un chevreau appartenant à la classe d’âge ‘i’, de sexe ‘j’ et soumis à un traitement ‘k’
μ est la moyenne générale;
Age i est l’effet aléatoire de l’âge en semaine des chevreaux avec i = 1 .....12 semaines;
Sexe j est l’effet fixé du sexe avec j = 1 (chevreau), j = 2 (chevrette);
Traitement k est l’effet fixé du traitement, avec k= 1 (lot témoin) et k = 2 (lot supplémenté);
Sexe i * Traitement k est l’effet de l’interaction traitement-sexe;
eijkl est le résiduel.
Ensuite, la matrice associant à chaque tranche d’âge, les quantités totales des ingrédients alimentaires consommés (luzerne, pois d’angole, fane d’arachide, son de blé et tourteaux de coton) et les performances pondérales enregistrées (poids corporel, tour de poitrine, longueur du corps et hauteur au garrot) des quatre chevreaux du lot expérimental, a été soumise à une Analyse en Composantes Principales (ACP) pour analyser les corrélations entre performances pondérales des chevreaux en croissance et l’apport de quantité d’ingrédient alimentaire dans les rations de leurs mères.
L’analyse a été ensuite orientée vers la régression linéaire du poids vif en fonction des paramètres morpho-biométriques des chevreaux. La relation entre ces variables a été ajustée à l’aide d’un modèle de régression linéaire à effet fixe avec le logiciel R (R.Core Team, 2013). L’effet du sexe et du traitement de supplémentation sur la relation linéaire entre le poids vif et les paramètres morpho-biométriques a été analysé en comparant les résidus du modèle linéaire sans les effets aléatoires aux implications potentielles aléatoires.
RÉSULTATS
Influence du régime supplémenté en fourrage vert sur les chèvres suitées
Une évolution en dent de scie à tendance décroissante du gain en poids corporel a été observée au cours des premiers mois qui ont suivi le chevronnage chez les deux lots, expérimental et témoin (Tableau 2). Le gain en poids corporel est meilleur pour les deux semaines qui ont suivi la mise-bas; puis décroît pour être négatif à la 8ième semaine et 9ème semaine respectivement pour le lot expérimental et le lot témoin, traduisant ainsi des pertes en poids au cours de ces deux semaines. La perte en poids est plus importante chez les animaux du lot témoin. Une reprise du gain en poids est observée au cours des deux dernières semaines d’expérimentation.
Au démarrage, l’indice de consommation (IC) était meilleur pour le lot expérimental avec la plus petite valeur de l’IC. Au-delà de la deuxième semaine, l’IC devient élevé avec la supplémentation en fourrage vert de luzerne et du pois d’angole. Au cours des deux dernières semaines de l’expérimentation, une amélioration de l’IC a été observée pour les deux lots.
Évolution des performances pondérales des chevreaux
L’évolution des performances pondérales au cours du temps ne montre pas de différences entre le lot expérimental et le lot témoins pendant le premier mois qui a suivi le chevronnage. A partir de la 5e semaine, l’analyse des deux courbes montre une supériorité des performances pondérales des chevreaux dont les mères ont été supplémentées en fourrage vert de luzerne et du pois d’angole par rapport aux chevreaux du lot témoin (Figure 2).
Par rapport au sexe, on remarque que l’effet de la supplémentation des mères n’est perceptible sur leur croissance qu’à partir de la 7e semaine (Figure 3 et 4). Les chevreaux (mâles) des mères complémentées avaient un gain de poids supérieur par rapport à ceux dont les mères n’étaient pas complémentées (Figure 3). Pour les chevrettes, l’impact de la complémentation des mères est perceptible dès la 5e semaine. L’écart de croissance entre le lot expérimental et le témoin est très net par rapport à celui des mâles (Figure 4).
Performances pondérales et facteurs de variation
Pour tous les paramètres morpho-biométriques étudiés, les chevreaux avaient un regain de performance plus élevé que les chevrettes (Tableau 3). Les chevreaux supplémentés avec le fourrage vert de luzerne et de pois d’angole ont une performance plus importante en tour de poitrine, en note d’état corporel et en poids corporel que le lot témoin sauf pour la longueur du corps et la hauteur au garrot pour lesquelles le gain était plus important pour les animaux sans supplémentation. L’interaction entre le sexe et le traitement révèle que les chèvres soumises au régime supplémenté avaient les chevreaux (mâles) avec le meilleur regain en note d’état corporel et en poids corporel que les chevreaux et chevrettes du lot témoin. Par contre, le regain en longueur du corps et hauteur au garrot était plus important chez les chevreaux (mâles) du lot témoin que chez tous les chevreaux (mâles et femelles) du lot supplémenté en fourrage vert de luzerne et de pois d’angole (Tableau 3).
Une différence hautement significative est observée selon le sexe des chevreaux pour les paramètres de performance étudiés, sauf pour la longueur du corps, la hauteur au garrot et la note d’état corporel des animaux (Tableau 4). De ces différences, les chevreaux ont plus fait preuve de gain de performances que les chevrettes. L’influence significative de la supplémentation en fourrage vert de luzerne et de pois d’angole des mères sur le gain en performances de leurs petits à la mamelle est aussi observée pour l’ensemble des paramètres étudiés, sauf la note d’état corporel. Le gain en performance des petits était de loin plus important avec la supplémentation des mères. Les interactions entre sexe et la supplémentation n’étaient globalement pas significatives pour la majorité des paramètres de performance étudiés, impliquant une efficacité de la supplémentation indépendamment du sexe des chevreaux, bien que les meilleurs résultats soient obtenus avec les mères supplémentées suitées de mâle.
Corrélations entre performances pondérales des chevreaux et les quantités d’ingrédients alimentaires apportée par les rations aux mères
Les deux premières composantes de l’ACP expliquent plus de 58 % de l’inertie totale, avec la majorité des variables interprétables sur le premier plan factoriel, conformément aux critères d’interprétation en termes de contribution et qualité de projection des variables sur les axes (Figure 5).
L’ACP indique, sur le 2e axe du plan factoriel que, plus les quantités de tourteau de coton deviennent importantes dans la ration des mères, plus leurs chevreaux perdaient en poids corporel. En moyenne, 0,6 kg de tourteau de coton par chèvre est donnée aux mères par jours. En revanche, plus on apporte de la luzerne verte dans l’alimentation des chèvres, leurs chevreaux gagnaient davantage en poids corporel et en hauteur au garrot (Figure 5). En moyenne 0,163 kg de luzerne vert par chèvre est donné aux mères. Le premier axe de l’ACP (côté négatif de l’axe) indique aussi une contribution plus importante du fourrage vert dans l’amélioration de la note d’état corporel, et donc, de l’état d’embonpoint des chevreaux. De même, pendant les périodes où l’apport de fane d’arachide était plus important, le cercle de corrélation de l’ACP indique un accroissement de la longueur du corps des chevreaux et une réduction marquée de leur note d’état corporel. L’apport moyen en fane d’arachide était de 1,5 kg/jour par jour chez les mères en régime supplémenté en fourrage vert de luzerne et de pois d’angole.
Influence de la supplémentation sur le format des animaux
Le poids corporel est plus lié au tour de poitrine (TP) qu’aux autres mesures morpho biométriques étudiées (Figure 6). La valeur élevée du R2 ajusté montre que la relation linéaire entre ces deux variables est très forte (Figure 6a). Le R2 ajusté est plus faible pour les relations du poids corporel établie avec la hauteur au garrot (Figure 6b) et la longueur du corps (Figure 6c). Une représentation graphique similaire de la relation linéaire entre le poids corporel et le tour de poitrine est observée entre le lot expérimental avec supplémentation en fourrage vert et le lot témoin sans supplémentation des chèvres (Figure 6d).
L’analyse des résidus standardisés montre que l’apport de la supplémentation dans le régime alimentaire des mères, encore moins le sexe des chevreaux, n’a eu d’effet significatif sur la relation précédemment décrite ente le poids corporel et le tour de poitrine des chevreaux. En effet, les moyennes des résidus, que ce soit pour les modalités du traitement de supplémentation ou du sexe des chevreaux, sont toutes négatives et présentent une très faible variation autour de la valeur zéro (Figure 7).
DISCUSSION
Dans la présente étude, le gain moyen quotidien en poids est compris entre (0,796 et -0,173 kg) pour le lot expérimental en régime supplémenté avec de la luzerne vert et de pois d’angole; ce qui est nettement supérieur à celui du régime témoin (0,513 et -0,586 kg). En plus, de meilleurs comme de mauvais indices de consommation ont été observés aussi bien pour le lot expérimental (22 à 193 kg MS/kg) que pour le lot témoin (30 à 80 kg MS/kg). L’amélioration du gain moyen quotidien pourrait être due à la qualité nutritive des fourrages verts nécessaires aux femelles qui doivent mobiliser les réserves corporelles pour couvrir ses propres besoins et ceux des chevreaux. Une mobilisation de nutriments plus importante que l’apport des rations alimentaires pourrait justifier les pertes en poids observées au cours de certaines périodes de l’expérimentation.
Les performances de croissance des chevreaux au cours de l’allaitement est importante à prendre en considération. L’effet indirect du régime supplémenté des mères en fourrage vert de luzerne et de pois d’angole sur les chevreaux apparaît, dans cette étude, à partir de la 4e semaine, avec un gain moyen quotidien largement supérieur aux chevreaux du lot témoin. Ces résultats sont meilleurs comparés au gain moyen quotidien de 8,3 g à 24,3 g rapporté par Elhadji-Nouhou (2014) dans une étude sur la complémentation des cabris roux de Maradi avec des gousses de Piliostigma reticulatum et à ceux rapportés par Akourki et al. (2019). Les résultats de la présente étude sont également supérieurs à ceux rapportés par Malam-Abdou et al. (2017). Ces auteurs ont rapporté un gain moyen quotidien de 29,8 g à 78,3 g selon la formule alimentaire analysée. Il est important de préciser que l’ensemble de ces études antérieures ont porté sur des cabris de race rousse, alors que la présente étude a porté sur des chevreaux depuis la naissance dont la croissance est plus rapide.
L’effet de l’alimentation en régime supplémenté du fourrage vert de luzerne et de pois d’angole sur la réponse du gain en poids corporel et des paramètres morpho-biométriques des chevreaux a été enregistré dans cette expérience. A la naissance, les mâles pesaient plus que les femelles. Les mâles sont apparus légèrement plus lourds que les femelles à la naissance, observation faite antérieurement par Marichatou et al. (2002). Les résultats de performance pondérale des chevreaux selon le sexe et le traitement montrent que les chevreaux mâles et femelles, avec des mères en régime supplémenté, ont un meilleur gain sur les paramètres morpho-biométriques que les mâles et femelles du lot témoin. Pour le poids corporel, le gain enregistré est compris entre 8,2 et 7,0 kg.Ce résultat est en adéquation avec les résultats rapportés par Salhi et al. (2019) (124 et 78 g/j, 115 et 74 g/j respectivement pour les mâles et les femelles), sur la population de chèvres sahariennes marocaines alimentées d’une ration de foin de luzerne et de concentré. En revanche, des poids moyens supérieurs ont été rapportés par ces mêmes auteurs en phase 2 (146 g/j), tandis que des poids moyens inférieurs ont été rapportés dans plusieurs études (Ahamefule et Etudo, 2010; Belay et al., 2015; Amine et al., 2019; Abou et al., 2019). Concernant les autres paramètres biométriques étudiés, les chevreaux du lot témoin ont montré une supériorité par rapport aux chevreaux du lot expérimental pour la longueur du corps et hauteur au garrot. L’allongement du corps et la prise en hauteur, face à un poids corporel plus faible pourraient d’ores et déjà être considérés comme un indicateur des déficits en supplémentation chez les chevreaux en croissance.
Par ailleurs, les moyennes des paramètres morpho-biométriques plus faibles aussi bien chez les chevreaux du lot expérimental que chez ceux du lot témoin, comparés aux valeurs moyennes couramment citées pour la chèvre rousse de Maradi et la chèvre du Sahel (Marichatou et al., 2002; Rahamané, 2002; Lahrech et al., 2020) peuvent être expliquées par l’âge plus jeune des animaux de la présente expérimentation (Ojedapo et al., 2007).
L’Analyse en Composante Principale révèle que, dans le régime alimentaire des mères, la luzerne puis le pois d’Angole ont été les ingrédients qui étaient le plus liés aux performances pondérales des chevreaux en croissance. Ainsi, plus on donne de la luzerne et le pois d’angole aux mères, plus cela impacte positivement les paramètres morpho-biométriques des chevreaux. Un apport de plus de fourrage vert en luzerne et en pois d’Angole serait souhaité, comme l’ont recommandé Rahamané et al. (2002) dans une autre étude similaire, afin d’améliorer leur niveau de production en lait et par conséquent le disponible de la part consommable par les petits et ainsi stimuler davantage la croissance des chevreaux. L’effet du fourrage vert peut être expliqué par la qualité de la ration (Landi-Agro, 2023). Cela peut être directement lié à la présence de divers nutriments dans ces deux légumineuses. En plus de fournir de l’énergie et des protéines, la supplémentation en luzerne et en pois d’angole a probablement contribué à apporter des niveaux supplémentaires de vitamines (A, E) et de minéraux (zinc, sélénium, iode) qui ont donné aux animaux une capacité de production laitière plus riche.
CONCLUSION
L’étude a permis, sur un échantillon de faible effectif, l’établissement et la comparaison des performances pondérales des chevreaux roux de Maradi pour décrire l’impact indirect de la supplémentation du fourrage vert de luzerne et du pois d’angole. Au terme de cette étude, le lot expérimental supplémenté se distingue nettement du lot témoin sur la base des gains moyens quotient en poids corporel. L’analyse en composante principale (ACP) indique la nécessité d’augmenter les quantités de la luzerne et du pois d’angole et de diminuer la part de certains concentrés dans le rationnement pour renforcer l’accroissement des performances pondérales des chevreaux. Des études plus poussées qui seront conduites sur des effectifs plus conséquents, permettront sans doute d’optimiser l’utilisation de ces deux légumineuses dans l’alimentation des petits ruminants.
RÉFÉRENCES
Abou S., Madou D., Sacko I., Sanogo S., Mamadou D.C., Traore D. (2022). Amélioration de la production de viande au Mali par l’introduction de la chèvre boer: croissance pondérale des croises boer x chèvre du sahel à la station de Same. Revue Malienne de Science et de Technologie, 3(28).
Adam K.M.G., Mani M., Dayo G-K., Marichatou H. (2019). Étude comparative des caractéristiques morpho-biométriques des chèvres Rousse et Noire de Maradi au Niger: analyse des paramètres quantitatifs et qualitatifs. Int. J. Biol. Chem. Sci. 13: 1431-1443.
Adjassin J.S., Assani A.S., Bani A.A., Sanni W.H.S., Adégbeïga A.C.D., Comlan A.B.G., Virgile A.E.B., Alkoiret I.T. (2022). Impact of heat stress on reproductive performances in dairy goats under tropical sub-humid environment. Heliyon,16:e08971.
Ahamefule F.O., Etudo M.D. (2010). Performance of West African Dwarf (WAD) Goats Fed Raw or Processed Pigeon Pea (Cajanus cajan) Seed Meal Diets. Nig. J. anim. Prod., 37: 227-236.
Akourki A., Sodo D.A-R., Idrissa S.D., Chaïbou I. (2019). Effets du tourteau des graines de Balanites aegyptiaca sur la consommation alimentaire et les performances zootechniques des cabris roux de Maradi. Int. J. Biol. Chem. Sci., 13: 3355-3363.
Amine M., Solomon G., Sandip B., Ayele A., Mestawet T., Alemnew A., Shanbel B. (2019). Growth performance of Boer goats and their F1 and F2 crosses and backcrosses with Central Highland goats in Ethiopia. Livestock Res. Rural Dev., 31: 89.
Aziada M.M., Ousseini M.M.M., Salissou I., Chaibou M. (2021). Pratiques et contraintes de l’élevage de la chèvre rousse de Maradi en milieu rural au Niger. Int. J. Biol. Chem. Sci., 15: 936-949.
Barazi A.A., Chaibou M., Mouctari O.M.M., El. Jinouhou M. (2019). Effet de la supplémentation des rations par un additif alimentaire sur la croissance pondérale et le rendement carcasse des chevreaux Roux de Maradi au Niger. Int. J. Biol. Chem. Sci., 13: 2487-2496.
Belay D., Mokonen T., Mesfin L., Nigus B., Asres Z., Misganaw W., Desalegn A., Solomon T.A. Ali Solomon A. (2015). On Station Growth Performance of Crossbred Goats (Boer X Central Highland) at Sirinka, Ethiopia. Asian Journal of Animal Sciences, 9: 454-459.
Bouchel, D., Sow, R.S., Bibe, B., Tixier-Boichard, M., Lauvergne, J.J., Poivey, J.P., Rognon, X. (2006). Caractérisation et cartographie des ressources génétiques caprines du Sénégal à l’aide d’indices phanéroptiques, d’indices morphobiométriques et de marqueurs moléculaires: méthodologie et résultats préliminaires. Rencontres Recherches Ruminants ,13: 257.
CIRAD (2018). État des filières laitières dans les 15 pays de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad Annexe 9: Fiche Niger, 41p.
Elhadji-Nouhou M. (2014). Effets d’une substitution du tourteau de graines de coton par les gousses de Piliostigma reticulatum (De Candolle) Hochstetter dans l’alimentation, sur les performances de croissance de la chèvre rousse de Maradi. Mémoire de Master: Productions Animales et Développement Durable, EISMV de l’Université Cheikh AntaDiop, Dakar, 40p.
Eric, V. (2020). Harmonized Body Condition Rating Guide for Farm Animals in the Sahel: Large Ruminants (Cattle, Camels) and small ruminants (sheep, goats) and equines (Asins and Equines). Cirad, UMR Selmet, Guide_NEC_Sahel.pdf.
FAOa (2013). Le développement du secteur de l’élevage pour la réduction de la pauvreté: perspectives économique et politique. FAO, Les nombreuses vertus de l’élevage, Rome, 206 p.
FAO (2013b). Phenotypic characterization of animal genetic ressources. Food and Agriculture, 158 p.
FAO.(2017). Revue des filières bétail/viande et de lait et des politiques qui les influencent au Niger. Rapport, 122 p.
Helliot K.D., Maurice C.A., Luc H.D. (2021). Comparison of some zootechnical performances of local and Red Maradi goats reared under smallholder production systems in the Sudanian zone of Benin, Veterinary and Animal Science, 14,:100210.
Lahrech A., Hamidi M., Hachi M., Choukri A., Laoun K. (2020). Étude des principaux paramètres biométriques des races caprines Arbia et Makatia en steppe Algérienne. Livest. Res. Rural Dev., 32 (12)
Landi-Agro (2024). Luzerne: source de protéine et de structure intéressante. [En ligne].
Malam-Abdou M, Salissou I., Abdou D., Germain J.S. (2017). Analyse technico-économique des aliments densifiés sur les performances de croissance de cabris roux de Maradi au Niger. Int. J. Biol. Chem. Sci., 11: 280-292.
Maman Lawal A.A., Chaibou M., Mani M. Garba M.M., Gouro A.S. (2018). Pratiques d’éleveurs et résultats économiques d’élevage dans les exploitations urbaines et périurbaines de Niamey. Int. J. Biol. Chem. Sci., 12: 294-309.
Marichatou H., Mamane L., Banoin M., Baril G. (2002). Performances zootechniques des caprins au Niger: étude comparative de la chèvre rousse de Maradi et de la chèvre à robe noire dans la zone de Maradi, Rev. Élev Méd. Vét. Pays Trop., 55: 79-84.
Mouctari O.M.M., Chaibou M., Mani M. (2017). Pratique et utilisation des sous-produits de légumineuse dans l’alimentation du bétail à la communauté urbaine de Niamey: Cas de fanes et cosses de niébé. J. Appl. Biosci., 120: 12006-12017.
Ojedapo L.O., Adedeji T.A., Olayeni T.B., Adedeji O.S., Abdullah A.R. Andojebiyi O.O. (2007). Influence of age on body weight and body linear measurements of extensively reared WAD Goats in derived savannah zone of Nigeria. J. anim. Vet. Adv., 6 114-117.
Rahamane S., Aime J.N., Hamidou H.T. (2002). La chèvre du Sahel au Burkina Faso: paramètres de reproduction, croissance pondérale et mesures morpho-biométriques des jeunes. Sciences Naturelles et Appliquées, 26: 7-16.
R Core Team (2013). A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
Soumana I., Ayssiwede S.B., Issa S., Guero .A. (2016). Effet de la complémentation avec des blocs multinutritionnels concentrés à base de Sida cordifolia L., une plante invasive, sur les performances zootechnico-économiques des antenais de race Balami à Déréké/Dosso (Niger). Inter. J. Innov. Applied Stud., 15: 716-730.
Salhi M., Mounsif M., Agdim H., Keli A. (2019). Effet du niveau protéique de la ration des chevreaux sur la croissance et les caractéristiques de la carcasse. In: Ruiz R. (ed.), López-Francos A. (ed.), López Marco L. (ed.). Innovation for sustainability in sheep and goats. Options Méditerranéennes: Série A, 123: 151-155.

Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Fondé(e) sur une œuvre à www.agrimaroc.org.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à www.agrimaroc.org.