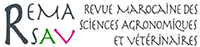Caractérisation de la richesse floristique du pâturage naturel au Kasaï-Oriental, RDC
DOI :
https://doi.org/10.5281/zenodo.16679013Mots-clés :
Carctérisation, Pâturage, Richesse, FloristiqueRésumé
Les pâturages naturels du Kasaï constituent la base alimentaire la moins coûteuse pour les herbivores. Pour gérer et sauvegarder la richesse floristique de la ferme Mutokoyi, sa connaissance est nécessaire. Ainsi, l’élaboration d’une base des données sur les ressources pastorales s’avère nécessaire pour la redynamisation des activés agropastorales dans la province. Cette étude a pour objectif de caractériser la richesse floristique à la ferme Mutokoyi (Kasaï-Oriental, RD Congo). Des relevés phytosociologiques ont été réalisés selon l’approche sigmatiste de Braun-Blanquet (1932). À partir de 43 relevés phytosociologiques, un total de 117 espèces composées de strates ligneuses, herbacées et lianes, réparties en 79 genres et 22 familles ont été recensées. Il ressort dans ladite ferme une flore assez riche, soit 35,9 taxums. Cette richesse a été dominée par une forte présence des thérophytes par rapport aux phanérophytes, majoritairement constitués des essences sauvages non appétibles pour les bovins. La classification ascendante hiérarchique de la richesse floristique (CAH) confirme une dominance des espèces de la famille des Poacées et des Fabacées par rapport aux Astéracées, Convolvulacées et Rubiacées et autres.
Mots clés: Pâturage naturel, Richesse floristique, Kasaï, RDC
Téléchargements
INTRODUCTION
La République Démocratique du Congo (RDC) est l’un des rares pays africains qui possède des pâturages naturels pouvant supporter jusqu’à 40 millions de têtes de bétails et une richesse floristique appétable représentée par un complexe végétal imposant de faciès variés (MA, 2010). Environ 10 531 espèces végétales d’une originalité remarquable végètent dans la nature (MECNDD, 2016). La plupart de ses grands groupes confondus fournissent généralement de la nourriture aux herbivores et en même temps une couverture permanente au sol capable de séquestrer le dioxyde de carbone et lutter contre les phénomènes érosifs (Klein et al., 2014).
Fort malheureusement, l’ensemble de ces pâturages naturels spontanés se réduisent aux actions combinées de la pression démographique, anthropique et de l’incertitude climatique sous toutes ses formes. De plus, la coupe de bois de chauffage observée, l’extension des surfaces cultivées et le feu de brousse incontrôlé pendant la chasse et la culture sur brûlis occasionnés spontanément par les habitants des villages environnants desdits pâturages naturels diminuent fortement les aires de parcours d’herbivores sous pâture, pour lesquels l’alimentation reste fortement tributaire de la disponibilité de la diversité biologique des espèces végétales spontanées.
Bio-géographiquement, le territoire de Tshilenge dans la province du Kasaï-Oriental en RD. Congo est dominé dans l’ensemble à 66,8 % par la savane herbeuse dans les secteurs de Kampatshi, Kalelu et Tshipuka, sauf son extrême sud à la limite avec le territoire de la Luilu dans la province de la Lomami et dans le secteur de Kalonji sud. Cette bande sud qu’occupe une grande partie la ferme Mutokoyi est de plus ou moins 33.1%. Elle est dominée par une savane arbustive floristiquement intéressante. Tandis que, dans la partie centrale du territoire (dans le secteur de Tshipuka), une savane herbeuse à même une allure de savane steppique est dominée par deux types biologiques: les graminées cespiteuses (en touffe) et les dicotylédones à souches ligneuses (Tshimanga, 2009).
Sur ce, l’alimentation des polygastriques à la ferme Mutokoyi repose entièrement sur le pâturage naturel qui dépend étroitement de la saison pluvieuse. Sa richesse floristique est caractérisée par des formations végétales où cohabitent de nombreuses espèces fourragères, herbacées et ligneuses, quelques-unes seulement sont consommables, et parfois uniquement à certaines périodes de l’année. Cependant, en situation de faible charge enregistrée dans ladite ferme, la diversité biologique des espèces végétales ne diminue pas alors que la composition floristique se trouve modifiée, il se produit un envahissement de la flore, accompagné d’un embroussaillement pouvant provoquer le remplacement à la longue d’un groupement floristique appétible par un autre non appétible.
Pour ce faire, la redynamisation des activités agropastorales dans la province du Kasaï-Oriental en général et à la ferme Mutokoyi en particulier, qui jadis couvraient les besoins carentiels en protéine animale et réduisaient les importations des produits carnés d’origine animale dans la région, consiste non seulement à repeupler les animaux domestiques et à réhabiliter les différentes fermes bovines, mais aussi à caractériser en amont la richesse floristique pour une connaissance exhaustive des espèces fourragères appréciées par les herbivores avant tout aménagement des pâturages naturels.
Cependant, depuis plus de 70 ans les inventaires taxonomiques intenses ne sont plus à l’ordre du jour en RD Congo. Les connaissances actuelles de la richesse floristique restent limitées, bien que certaines études importantes aient été réalisées par plusieurs chercheurs entre 1947-1955 en RD Congo d’une manière générale par Lebrun, Mullenders, Schmitz et autres in Lassa et al., (2019).
Ainsi, face à cette situation, cette étude sera circonscrite relativement sur la caractérisation de la richesse floristique en vue d’identifier d’une manière précise les espèces existantes pour une connaissance exhaustive des ressources fourragères pâturées par les polygastriques à la ferme Mutokoyi et de déterminer la richesse moyenne de ces ressources avant tout aménagement de pâturage naturel.
Toutefois, il est impossible d’aménager, de restaurer et de conserver la richesse floristique que regorge la ferme Mutokoyi si elle n’est pas connue. Ainsi, dans l’intérêt général, une mise à jour dans ce domaine et suivie de l’élaboration d’une base des données permanente de ladite richesse s’avèrent très nécessaire pour redynamiser les activés agropastorales dans la province du Kasaï-Oriental en général et à la ferme Mutokoyi en particulier.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Milieu d’étude
La ferme Mutokoyi est située dans la partie Sud-Est du territoire de Tshilenge au Kasaï-Oriental, en République Démocratique du Congo. La position géographique la situe à 06°41’31.88’’ de latitude Sud, 023°38’ 56.58’’ de longitude Est et à 623 m d’altitude. Elle est caractérisée par un climat tropical humide du type AW3 avec l’alternance de deux saisons dont la saison pluvieuse (du 15 août au 15 mai) et la saison sèche (du 15 mai au 15 août). La moyenne des précipitations est de 1425.8 mm de pluies, et la température moyenne du mois le plus chaud de 28.2°C en avril et le minima moyen du mois le plus froid de 24.4°C en juillet. L’humidité atmosphérique relative est de 72.6%, la température annuelle de l’air varie entre 25°C dans la Nord, à 22.5°C dans le Sud et la durée d’insolation est de 2400 heures/an (NASA, 2024; Musambayi et al., 2022; Bamba, 2006).
Le relief de la ferme Mutokoyi est un bas plateau moutonné dont les altitudes varient entre 600 m dans la vallée de la Luilu à 650 m sur la crête de ce versant (Musambayi et al., 2022; Polinard, 1935). Sa géologie est dominée par deux grandes formations: les roches granitiques en profondeur et parfois affleurent en surface, la formation de couverture dominée par les roches siliceuses (Musambayi et al., 2022). Le réseau hydrographique de la ferme est constitué par la rivière Luilu (Kalelu) à l’est, la rivière Lufingila au Sud et la rivière Mutokoyi au Nord (Omasombo et al., 2014; Ngongo et al., 2009).
Concernant les aspects humains, le territoire de Tshilenge est habité par les Bakwa Kalonji ka Tshimanga. La ferme Mutokoyi est entourée par les groupements de Bena Malengele, Bakwa Malaba, Bena Mukendi, Bena Tshibanda, Bena Kamama, et Bena Kalombo. Le réseau routier est dominé par deux routes: une allant de Bena Malengela à Bena Tshibamba en passant par le Bakwa Malaba et Bena Mukendi et une autre reliant Bena Tshibanda à Bena Kalombo (Omasombo et al., 2014).
Pour les aspects pastoraux, la Société pour l’agriculture et l’élevage au Congo (SEC)/Kambayi était sectionnée en plusieurs stations (Ndianyama, Katshia, Mudiba, Mulunguyi, Tshilunde et Mutokoyi) dans le but de fournir à la MIBEÉKA (MIBA) et la population Kasaïenne en général la viande et le lait (Omasombo et al., 2014). De ce fait, la section Mutokoyi qui fait l’objet de la présente étude est l’une des plus vastes fermes de la province du Kasaï Oriental (989 ha). Elle comptait plus de 3000 cheptel bovin vers les années 1936 et 1500 en 1985 et actuellement moins de 300 têtes bovines, utilisant entièrement la richesse floristique spontanée comme sources d’alimentation.
Matériels d’étude
Le matériel végétal sous cette étude était constitué des herbiers de différentes espèces végétales recensées dans le pâturage naturel spontané de la ferme Mutokoyi. Quant aux matériels techniques, deux fiches ont été utilisées: une fiche d›enquête antérieure, conçue sur la base d’une enquête pastorale qui a été réalisée en amont pour connaitre la diversité biologique des espèces végétales existantes avant l’installation de la ferme Mutokoyi en 1935 et les pratiques antérieures qui expliquent l’état de la végétation observée et du cheptel et une autre normalisée pour collecter les données brutes des différents relevés phytosociologiques. Aussi, deux ouvrages ont été notamment utilisés: des Guides pour une identification facile des espèces et flore pour la détermination basée sur le travail taxonomique par clés dichotomique.
Méthodes d’étude de la végétation et techniques
Les inventaires phyto-sociologiques ont été couplés aux inventaires écologiques. Pour identifier la flore dans ladite ferme, les relevés phyto-sociologiques ont été effectués dans les placettes selon la méthode sigmatiste de Braun-Blanquet (1932) (Ndiaye, 2024; François 2000; Katkoré et al., 2019). Les données brutes ont été récoltées sur les fiches normalisées (Anonyme, 2008).
En raison de la variabilité spatiale des peuplements, la méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié dans les zones de pâturage a été utilisée pour décrire l’ensemble de la flore. Une liste floristique exhaustive de toutes les espèces a été dressée et chaque espèce ligneuse, herbacée et liane s’est vue attribuer une cote d’abondance dominance selon un ratio abondance – recouvrement:
L’échantillonnage était fait sur base des critères bio-physionomiques (forêt, savane, steppe et désert) et mésologiques (le milieu, substrat, climat, topographie) (Katkoré et al., 2019) obtenus à partir des images satellitaires de la zone (Google Earth et Landsat) et NASA. De ce fait, il s’agit de l’acquisition du support cartographique, la répartition de la zone d’étude, la mission de reconnaissance du terrain, les relevés des coordonnées des points et leur codification. L’interprétation des images, la correction et la finalisation des cartes avait permis de déterminer: les zones d’habitation, les zones de pâturage, le couloir de passage, les cours d’eaux, les zones des cultures et les zones dégradées. Ainsi, sur chaque zone identifiée de pâturage a été placée des placettes rectangulaires de 1 000 m2 (20 m x 50 m) distant de plus de 250 m (Ndiaye, 2024; Katkoré et al., 2019; Laurent et al., 2017). Au total, 43 relevés phyto-sociologiques ont été effectués dans ces placettes selon la méthode Sigmatiste de Braun-Blanquet (1932).
Les analyses des données ont porté sur les analyses écologiques et la classifications ascendantes hiérarchique.
Les spectres écologiques sont celles partagés par des nombreuses études (Katkoré et al., 2019; Oumarou, 2003). Ainsi, les données quantitatives de l’inventaire de la végétation ont été saisies et traitées à l’aide du tableur Excel notamment: la fréquence spécifique, la richesse floristique, l’indice de diversité de Shannon Weaver (H), l’indice d’équitabilité de Piélou (E) et l’indice de Jaccard (Pj).
Les classifications ascendantes hiérarchiques (CAH) ont permis de grouper la richesse floristique suivant les plans factoriels à base des coordonnées principales des ACP. Les pâturages sont nommés à partir des espèces les plus abondantes selon la nomenclature des familles recensées (Akoégninou et al., 2006).
RÉSULTATS
Phytodiversité et types biologiques
L’inventaire floristique réalisé dans le pâturage naturel à la ferme Mutokoyi a montré l’existence de 117 espèces composées de strates ligneuses, herbacée et lianes réparties dans 79 genres et 22 familles: La famille la plus représentée des arbustes: Fabacée (2 espèces, soit 1,71 %); Les herbacées: Poacée (39 espèces, soit 33,3 %), Fabacée (26 espèces, soit 22,2 %), Astéracée (9 espèces, soit 7,69 %); Rubiacée (5 espèces, soit 4,27 %) et Convolvulacée (4 espèces soit 3,42 %) et les lianes: Fabacée (3 espèces, soit 2,56 %).
Pour les genres: la famille des ligneuses et des lianes la mieux représentée est: le Fabacée avec 2 genres chacune, soit 2,53 % et les herbacées les mieux représentées sont: Poacée (22 genres soit 27,8 %), Fabacée (11 genres soit 20,2 %), Astéracée (7 genres soit 8,86 %) et Rubiacée (5 genres soit 6,33 %). Ainsi, les espèces avec un nombre élevé de citation dans l’ensemble de 43 relevés phyto-sociologiques. Les ligneuses: Fabacée (61 citations, soit 3,96 %); les lianes: Fabacée (63 citations, soit 4,09 %) et les herbacées: Poacée (633citations, soit 41,0 %), Fabacée (241 citations, soit 15,63 %) et Astéracée (111 citations, soit 7,20 %) (Tableau 1).
Spectre global sur le type biologique
L’analyse floristique au sein du type biologique montre une prédominance des thérophytes par rapport aux cryptophytes ou géophytes rhizome, cryptophytes ou géophytes bulbe, phanérophytes grimpants, chaméphytes, cryptophytes ou géophytes tubercule et phanérophytes fructosa et hemi-criptophites (Figure 2).
Le cortège floristique à la ferme Mutokoyi, confirme l’abondance des thérophytes comme plantes favorables à la saison de pluie et passent la saison défavorable sous forme de graine. De ce fait, l’abondance dudit type biologique n’est pas du tout favorable pour un élevage de rente par rapport à son cycle végétatif court et de son exigence en eau.
Richesse floristique
Cette analyse détermine la richesse spécifique (S) en termes de nombre total de taxons/espèces enregistrées par groupement végétal. Elle prend ainsi en compte la diversité Alpha (l’indice de diversité de Shannon et l’équitabilité de Piélou) et la diversité Bêta par le biais de l’indice de Jaccard.
Les 43 relevés phyto-sociologiques (50 m x 20 m) ont été inventoriés. Le nombre des espèces floristiques par relevé variait de 22 à 52 avec une richesse moyenne de 35,9 taxums ou espèces et un écart type de ± 3,88 (Tableau 2).
Ainsi l’Indice de diversité de Shannon-Wienner (H=4,69 bits), révèle une forte diversité au sein du groupement végétal. De ce fait, ceci confirme que les conditions des stations sont très favorables à l’installation d’un grand nombre d’espèces dans des proportions quasi-égales.
Quant à l’équitabilité de Piélou (E=0,64) qui traduit le degré de diversité, toutes les espèces ont presque le même recouvrement. Ainsi, il sied de noter que l’Indice de Jaccard (Ij=23,0%), confirme que les placettes des groupements en comparaison deux à deux, étaient différentes et ne partageaient pas beaucoup d’espèces en commun.
Classification ascendante hiérarchique de la richesse floristique (CAH)
Le premier groupe des espèces plus abondantes se trouve dans les familles de Fabacées et Poacée, suivi du deuxième groupe comprenant, les familles peu nombreuses dans le pâturage naturel spontané, notamment composé des Astéracées, Convolvulacées et Rubiacées et le troisième groupe moins nombreux regroupe les familles suivantes: Malvacées, Amaranthacées, Solanacées, Cypéracées, Euphorbiacées, Portulacacées, Acanthacées, Rhamnacées, Zingibéracées, Rosacées, caesalpiniacées, Ecliptacées, Urticacées, Tiliacées, Moracées et Nyctaginacées (Figure 3).
DISCUSSION
Phytodiversité
L’analyse de la flore à la ferme Mutokoyi a porté sur la phytodiversité d’une part puis, sur la richesse floristique d’autre part. Les relevés de végétations de ce pâturage révèlent une florule de 117 espèces réparties en 22 familles et 79 genres, parmi les espèces inventoriées issues des trois strates ligneuses, herbacées et lianes. D’une manière générale, la famille des Poacées domine avec 22 genres et 39 espèces soit 41,0 %, suivi de la famille des Fabacées avec 20 genres et 31 espèces soit 23,7 %, puis celle des Astéracées avec 7 genres et 9 espèces soit 6 %. Ainsi, les 12 autres familles sont les moins représentées.
La divergence observée du point de vue quantitatif entre Poacée, Fabacée et autres familles recensées à la ferme Mutokoyi, pourrait être expliquée par le fait que les graminées (Poacées) dites espèces cosmopolites, possèdent une ascendance dans divers peuplements en pâture à cause de leur grande vitesse de repousse après le passage des animaux et du feu de brousse, et leur tallage (Kouadja et al., 2022; Issoumane et al.; 2021; Masharabu, et al., 2019; Amboua et al., 2019; Katkoré et al., 2019; Melom et al., 2015; Diallo et al., 2015; Bechir et al., 2015).
D’après Djohy et al., (2022), Baderhekuguma et al., (2019), Dourma et al., (2018), Amegnaglo et al., (2018) et Oumorou et al., (2010), la présence des Légumineuses (Fabacées) fourragères est un indicateur appréciable des qualités et sa dominance par rapport à d’autres familles dans certains parcours naturels est considérée comme indice d’un pâturage naturel riche par rapport à d’autres espèces.
De ces constats, les résultats obtenus à la ferme Mutokoyi sont presque similaires avec ceux trouvés par d’autres chercheurs dans les régions inter et subtropicales de l’Afrique, notamment Djohy et al., (2022); Kouadja et al., (2022), Loabe et al., (2020), Katkoré et al., (2019), Baderhekuguma et al., (2019), Amegnaglo et al., (2018), Diallo et al., (2015) et Melom et al., (2015), confirment les écarts excessifs et la prééminence des certaines familles par rapport à d’autres. Ainsi, la forte proportion des Poacées dans la plupart des zones d’étude peut s’expliquer par le fait que ces taxons possèdent une très grande possibilité de repousse et se retrouvent dans tous les relevés. Les Poacées et les Fabacées offrent un potentiel fourrager très important qui favoriserait l’exploitation de la zone à des fins pastorales.
Néanmoins, certains résultats trouvés par quelques chercheurs dans le domaine similaire ont essayé de démontrer d’une autre façon les écarts entre effectifs des espèces fourragères inventoriées sur divers pâturages naturels en Afrique. D’après Idrissou et al., (2020) et Jordan et al., (2005), l’écart pourrait s’expliquer par le fait que les différences entre les surfaces explorées/ les stations ou surfaces des relevés considérés, les nombres de relevés et différentes périodes qu’ont été élaborés ces relevés d’une région à l’autre ne sont pas les mêmes.
Richesse floristique
L’analyse de la richesse floristique (effectif des familles, des genres et des espèces) a été évaluée 1542 répétitions sur 43 relevés (50 m x 20 m) d’une superficie totale de 43 000 m2. Ainsi, il s’est avéré une discrimination entre les richesses floristiques recensées dans différentes stations appartenant à diverses unités de milieu à la ferme Mutokoyi. Le nombre de la richesse floristique des espèces fourragères par relevé varierait de 22 à 52 espèces avec une moyenne de 35,9 taxums ou espèces, soit une richesse assez riche dans ledit pâturage et un écart type de ± 3,88. Cette recherche a mis en exergue d’autres caractéristiques traduisant le degré de diversité biologique végétale par rapport au maximum théorique. La valeur des indices de diversité de Shannon dans ledit pâturage était de (H=4,69 bits), (E=0,36) pour l’équitabilité de Pielou et celui de Jaccard (Ij= 23,0%).
Daget et Poissonet (1997) et Connor et Simberloff (1978) in Anonyme (2008), confirment que la richesse floristique rend compte d’une partie de la diversité au travers de la flore par le nombre de taxons inventoriés dans l’unité de milieu considérée. Malencontreusement, la divergence observée entre effectif des richesses floristiques par relevé ou station s’expliquerait par fait que ces milieux sont sujets aux pressions anthropiques et aux effets de pâture provoqués par le passage des herbivores.
Les résultats trouvés à la ferme Mutokoyi sont en harmonie avec ceux trouvés par Kouadja et al., (2022) et Amegnaglo et al., (2018). Il a été démontré une forte divergence du point de vue numérique entre effectifs des taxums ou espèces recensées au sein des stations appartenant à diverses unités de milieu dans différentes zones d’étude africaine. Par conséquent, Il est de même pour les indices de diversité de Shannon, d’équitabilité de Pielou et celui de Jaccard.
Concrètement, la divergence observée entre effectifs des taxums ou espèces qui déterminent la richesse floristique à la ferme Mutokoyi, pourrait être expliqué par le nombre de relevés qui ont été réalisés et les conditions édaphiques et microclimatiques probablement différentes. Cependant, Daget et al., (2010) confirme que, le recensement des richesses floristiques est un élément clé permettant de calculer la richesse moyenne des stations. Une richesse assez riche varie entre 31 à 40 taxons ou espèces. Sur ce, les résultats obtenus dans ladite ferme confirment une richesse assez richesse, soit 35,9 taxums.
Prééminence entre espèces du spectre biologique
Il ressort de l’analyse physionomique que prend une espèce végétale au cours de son cycle biologique en relation avec son comportement vis-à-vis du milieu et notamment son aptitude à supporter la mauvaise saison. Ce qui suit: Les thérophytes (55 %) dominent dans tous les types d’occupation des sols à la ferme Mutokoyi, dont notamment on retrouve 73 % d’espèces identifiées comme plantes annuelles, suivis des cryptophytes (géophytes rhizome 13 % et géophytes bulbe 12 %).
Comparativement aux thérophytes et cryptophytes qui sont dominats, les autres formes de vie sont moins représentées dans le pâturage naturel à la ferme Mutokoyi, notamment: les phanérophytes grimpants, les cryptophytes ou les géophytes tubercules et les phanérophytes fructosa, les phanérophytes (pérennes) et des Hemi-cryptophytes représentés sous forme des plantes bisannuelles.
Dans le même ordre d’idée, les résultats obtenus par Leclercq et al., (2020) et Bechir et al., (2015), corroborent avec ceux trouvés dans cette étude. Ils démontrent que « La prééminence des thérophytes dans un pâturage naturel est d’une part, l’expression du substrat sableux (cas du pâturage naturel à la ferme Mutokoyi) et témoigne d’autre part, de leur adaptation aux stress climatiques ». La similarité entre les résultats trouvés à la ferme Mutokoyi et ceux trouvés par Katkoré et al. (2019); Oumorou et al., (2010), réside sur les caractéristiques que traduiraient l’environnement sec dans la plupart des zones d’études en Afrique.
Malgré cette diversité floristique de ressources fourragères dans la savane arbustive à la ferme Mutokoyi, ce travail a montré une proportion moins importante des espèces ligneuses (fructosa) appétibles (Antada abysinica Steud, Bauhinia variegate, Cajanus cajan et Morus nigra). La grande partie des espèces ligneuses à la ferme Mutokoyi était constituée des essences sauvages non appétible par les bovins. Cette configuration, confirme qu’elle conserve encore sa flore originelle malgré les fortes pressions anthropique observées tout autour de la ferme Mutokoyi.
Hiérarchisation de la flore
La classification des espèces par ordre d’importance a permis d’obtenir les résultats sur 22 familles, les fréquences de citation des espèces les plus abondante sur l’ensemble confirment 2 familles: les Poacée et les Fabacées, suivi par 3 familles: les Astéracées, Convolvulacées et Rubiacées et autres.
Ces résultats rapprochent ceux de Ollo et al., (2020); Diallo et al., (2015); Ndiaye et al., (2015) qui, dans leurs travaux ont prouvé que les espèces de la famille des Poacée et des Fabacées suivi des Rubiacée et des Convolvulacée étaient les plus nombreuses dans le pâturage naturel. Il en est de même avec à ceux effectués par Amegnaglo et al., (2018) dans six différents pâturages naturels. La richesse floristique inventoriée confirme la prééminence de deux familles (Poacées et Fabacées) suivi soit des Cypéracée, soit des Rubiacée ou autre espèce proche des familles trouvées.
Selon les résultats obtenus par Honvou et al., (2021) et Adomou et al. (2006), les facteurs responsables de la divergence entre familles, proviendrait pat les variations des conditions pédoclimatiques qui souvent influencent la distribution spatiale et géographique des flores. La prédominance des Poacées, des Fabacées suivi des Astéracée, des Rubiacée et des Convolvulacée et autres espèces a été confirmée par les résultats trouvés dans cette étude. Ils corroborent aux résultats trouvés par (Kouassi et al., 2020; Akoègninou et al., 2006).
CONCLUSION
La présente étude avait pour objectif de caractériser la richesse floristique dans le pâturage naturel à la ferme Mutokoyi (territoire de Tshilenge au Kasaï-Oriental en R.D. Congo). La diversité biologique des espèces végétales montre l’existence de 117 espèces composées de strates ligneuses, herbacée et lianes réparties dans 79 genres et 22 familles. Ainsi, il ressort dans ladite ferme une richesse floristique assez riche, soit 35,9 taxums ou espèces avec un écart type de ± 3,88. Un indice de diversité de Shannon-Wienner (H) était de 4,69 bits, confirmant une forte diversité au sein du groupement végétal traduisant une station favorable à l’installation d’un grand nombre d’espèces. L’indice d’équitabilité de Piélou (E) 0,36 indiquant que toutes les espèces ont presque le même recouvrement et celui de Jaccard (Ij) 22,97% montrant que les placettes des deux groupements étaient différentes et ne partagent pas beaucoup d’espèces en commun. Malgré cette diversité floristique de ressources fourragères, la proportion phanérophytes (Antada abysinica Steud, Bauhinia variegate, Cajanus cajan et Morus nigra) demeure moins importante par rapport aux thérophytes. Sur ce, la grande partie des phanérophytes sont constituées des essences sauvages non appétibles par les bovins. La classification des espèces par ordre d’importance confirme une discrimination entre trois groupes: les espèces de la famille des Poacées et des Fabacése les plus abondantes, suivi les espèces de la famille des Astéracées, Convolvulacées et Rubiacées et d’autres familles moins représentées.
RÉFÉRENCES
Adomou F. Koffy (2006). Le pastoralisme dans le Boboye et le Zarmaganda, continuité et rupture. In Bourgeot A. (Ed.) Horizons Nomades en Afrique Sahélienne. Karthala, pp: 327-338.
Akoègninou A., Van Der Burg W.J., Van Der Maesen L.J.G. (2006). Flore Analytique du Bénin. Backhuys Publishers: Netherlands; 1033 p.
Amboua I.O., Assongba Y.F., Yoka J., Parisse Akouango P., Djego J.G. (2019). Effet des arbustes sur la diversité floristique et la production herbacée dans les pâturages au ranch d’Essimbi à Boundji (République du Congo). Journal of Applied Biosciences,134: 13618-13629.
Amegnaglo K.B., Dourma M., Akpavi S., Akodewou A., Wala K., Diwediga B., Atakpama W., Agbodan K.M.L., Batawila K., Akpagana W.(2018). Caractérisation des formations végétales pâturées de la zone guinéenne du Togo: typologie, évaluation de la biomasse, diversité, valeur fourragère et régénération. Rev. Int. J. Biol. Chem. Sci., 12: 2065-2084.
Anonyme (2008). Guide méthodologique pour l’étude et le suivi de la flore et de la végétation. Collection ROSELT/OSS- Contribution technique.174p.
Baderhekuguma N., Cinyabuguma L.E., Kaboyi I., Musakamba M.M., Mutagoma B.C., Dumbo P., Nangalire N., Ruphine B.N., Cizungu N.L., Baluku B. (2019). Identification de quelques éspèces fourragères dans les pâturages en groupements de bugorhe, bushumba, irhambi et miti en territoire de kabare, RD Congo. Global Scientific J., 7:1476-1488.
Bamba I. (2006). Étude de la structure spatiale et de la dynamique spatio-temporelle d’un paysage dans l’ex-Bas Congo (RD. Congo). Mémoire DEA. Université libre de Bruxelles, Belgique.
Bechir A.B., Mopate L.Y., KaboreZoungrana C.Y. (2015). Évaluation de la disponibilité saisonnière du fourrage ligneux en zone soudanienne du Tchad: cas du terroir de N’Guetté. Int. J. Biol. Chem. Sci., 3: 135146.
Bechir A.B., Logtene Y. Mopaté (2015). Analyse de la végétation pâturée autour des ouvrages hydrauliques dans le Département du Batha Est au Tchad, Rev. Int. J. Biol. Chem. Sci., 9: 1557-1570.
Daget P., Poissone T.J., Huguenin J. (2010). Prairies et pâturages, méthode d’étude et interprétation, Cnrs/Cirad, 955p.
Diallo M.D., Ndiaye O., Diallo A., Saleh M.M., Bassene C., Wood S.A., Diop A., Guisse A. (2015). Influence de la litière foliaire de cinq espèces végétales tropicales sur la diversité floristique des herbacées dans la zone du Ferlo (Sénégal). Rev. Int. J. Biol. Chem. Sci., 9: 803-814.
Djohy G.L., Bouko B.S., Idrissou Y., Saliou R., Yacoubou B., Natta A. (2022). Productivité des pâturages naturels dans le bassin de l’Ouémé Supérieur au Bénin dans un contexte de changements climatiques. Livestock Research for Rural Development, 34:1-9.
Dourma M., Randrantoarimbola L., Woegan Y.A., Kanda M., Akpavi S., Akpagana K. (2018). Les pâturages naturels de la périphérie de Lomé au Togo: Diversité, typologie et qualité du fourrage. Rev. Mar. Sci. Agron. Vét., 6: 526-536.
François G. (2000). La phytosociologie synusiale intégrée: Guide méthodologique Université de Neuchâtel-Institut de Botanique, Neuchâtel, Suisse, 68p.
Honvou S.H.S., Aboh B. A., Sewade C., Teka O., Gandonou B.C., Oumorou M., Sinsin B. (2021). Diversité floristique, structure et distribution des groupements végétaux des parcours d’accueil des transhumants dans la Basse et Moyenne Vallée de l’Ouémé au Bénin. Rev. Int. J. Biol. Chem. Sci., 15: 81-96.
Idrissou Y., Mama Sambo Seidou Y., Assani Seidou A., Sanni Worogo H.S., Assogba B.G.C. Alkoiret Traoré I., Houinato M. (2020). Influence du pâturage et du gradient climatique sur la diversité floristique et la productivité des parcours naturels au Bénin. Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, 73: 161-157.
Issoumane M.S., Guimbo I.D., Rabiou H., Moussa M.S. Mouctari Ousseini M.M., Chaibou M. (2021). Analyse des critères paysans d’appréciation de la palatabilité des herbacées fourragères spontanées et fonctionnement des pâturages naturels du centre ouest du Niger (Afrique de l’Ouest Sahélienne). Rev. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 14: 68-80.
Jourdan J.P., Saley M.B., Kouame K.J., Kouadio B.H., Biémi J., M. Razack (2005). Gestion et protection des ressources en eaux souterraines: contribution d’un SIG à la réalisation de la carte de vulnérabilité à la pollution des aquifères fissures de Korhogo (Nord de la Côte d’Ivoire) selon la méthode DRASTIC. La conférence Francophone ESRI «SIG 2005», Paris (France), 16 p.
Katkoré B., Moussa M., Soumana I., Mahamane A., Abasse T., Larwanou M. (2019). Effet des variables Agro-écologiques sur la distribution de la végétation de la Rôneraie Anthropisée de Dasga au Niger. Rev. European Scientific Journal, 15: 406-422.
Klein H.D., Rippstein G., Huguenin J., Toutain B., Guerin H. (2014). Les cultures fourragères (264 p.). éditions Quae.
Kouadja G.S., Kouassi A.F., Kouadio K.E. (2022). Biodiversité, typologie et qualité du fourrage des parcours naturels périurbains de Bouaké au Centre de la Côte d’Ivoire. J. Anim. Plant Sci., 52: 9362-9376.
Landa B.R.Z., Nyongombe U., Monzambe M. (2013). Évaluation de la gestion des plantes fourragères résistantes pendant la saison sèche en zone de savane par les communautés locales (cas du bassin de l’Uele). Congo Sciences, 1: 14-22.
Lassa K.L., Kikufi B.A., Ilumbe B.G., Biloso M.A., Masens D.A.M., Habari M. J-P., Lukoki L.F. (2019). Etude floristique, écologique et phytogéographique des espèces utiles du territoire de Kimvula, R.D. Congo. Congo Sciences, 7: 91-101.
Laurent E., Deslussus L., Hardegen M. (2017). Guide méthodologique: méthode d’inventaire et cartographie des groupements végétaux. Conservatoire botanique national de Brest, grande Bretagne, 76 pages.
Loabe P. A., Yamndou S.T., Damba R., Djoumessi A.D. (2020). Evaluation qualitative des espèces fourragères présentes dans le département de la Bénoué (Nord Cameroun). Rev. Int. J. Biol. Chem. Sci., 14: 1381-1389.
Masharabu T., Butore J., Sindaye D., Hitimana M. (2019). Diversité floristique et distribution potentielle des essences fourragères spontanées au Burundi. Rev. Géo-Eco-Trop., 43: 161-170.
Melom S., Mbayngone E., Bechir A.B., Ratnan N., Mapongmetsem P.M. (2015). Caractéristiques floristique et écologique des formations végétales de Massenya au Tchad (Afrique centrale). Journal of Animal and Plant Sciences, 25: 3799-3813.
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable (MECNDD) (2016). Stratégie et plan d’action nationaux de la biodiversité (2016-2020). RD Congo.
Ministère de l’Agriculture. (2010) (décembre). Étude du secteur agricole: phase II, Plan directeur de développement agricole et rural, province du Kasaï-Oriental. Rapport final. RD Congo.
Musambayi C., Mayiba T., Tshibanda A., Mutombo H., Kabemba M., Gaston Citenga G. (2022). Caractérisation géochimique des formations carbonatées de l’est de la ville de Mbujimayi (Secteur de Lukelenge): Utilité dans les travaux de génie-civil. International Journal of Innovation and Applied Studies, 37: 818-829.
NASA (2024). Native resolution monthly and annual. -Begin Header Power Ceres/Merra2. Dates (month/day/year): 01/01/1981 through 12/31/2022. Location: Latitude -6.6922 Longitude 23.6492/Elevation from MERRA-2: Average for 0.5 x 0.625-degree lat/lon region = 668.36 meters the value for missing source data that cannot be computed or is outside of the sources availability range: -999 Parameter(s).
Ndiaye C., Ngom S., Traore E.H., Ndiaye S.A., Akpo L.E. (2015). Predicting the amount of biomass produced grassland depending on the rainfall recorded in the Sahelian area of North – Senegal in West Africa. International Journal of Advanced Research, 3: 382-396.
Ndiaye M.B. (2024). Caractérisation et production des herbages de la Réserve Communautaire Naturelle de Koyli Alpha et sa périphérie au Ferlo (Nord-Sénégal). Mémoire de Master, Département d’Agroforesterie, Université Assane Seck de Ziguinchor au Sénégal.
Ngongo L., Van Ranst E., Baert G., Kasongo E.L., Verdoodt A., Mujinya B.B., Mukalay J.M. (2009). Guide des sols en R.D. Congo, Tome I: Guide de gestion. UNILU, Lubumbashi, 262p.
Ollo S., Eliel G-G., Valérie M.C., Bougouma Y., Blanchard M., Vall E. (2020). Conception, installation et évaluation de banques fourragères arbustives pour l’alimentation des vaches laitières dans l’ouest du Burkina Fas. Rev. d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, 73: 27-35.
Omasombo J. kadima B., stradsant E., Olela D., Simons E., Kandindula L., Biayi J-W. samuntu M. tambwe J-P. Krawczyk J., Laghmouch M. (2014). Kasaï-Oriental un nœud gordien dans l’espace congolais, République démocratique du Congo. Musée royal de l’Afrique centrale.
Oumorou M., Boya A.A., Babatounde S., Houinato M., Sinsin B. (2010). Valeur pastorale, productivité et connaissances endogènes de l’effet de l’invasion, par Hyptis suaveolens L. Poit., des pâturages naturels en zone soudano-guinéenne (Bénin). Rev. Int. J. Biol. Chem. Sci., 4: 1262-1277.
Polinard E. (1935). La géographie physique de la région du Lubilash, de la Bushimaie et de la Lubi vers le 6e parallèle Sud. G. van Campenhout. 78p.
Tshimanga M. (2009). Le rôle de l’artisanat minier du diamant dans l’organisation régionale: Cas de Mbujimayi et ses environs au Kasaï-Oriental, RDC. Thèse de doctorat en géographie, Lubumbashi.

Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Fondé(e) sur une œuvre à www.agrimaroc.org.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à www.agrimaroc.org.